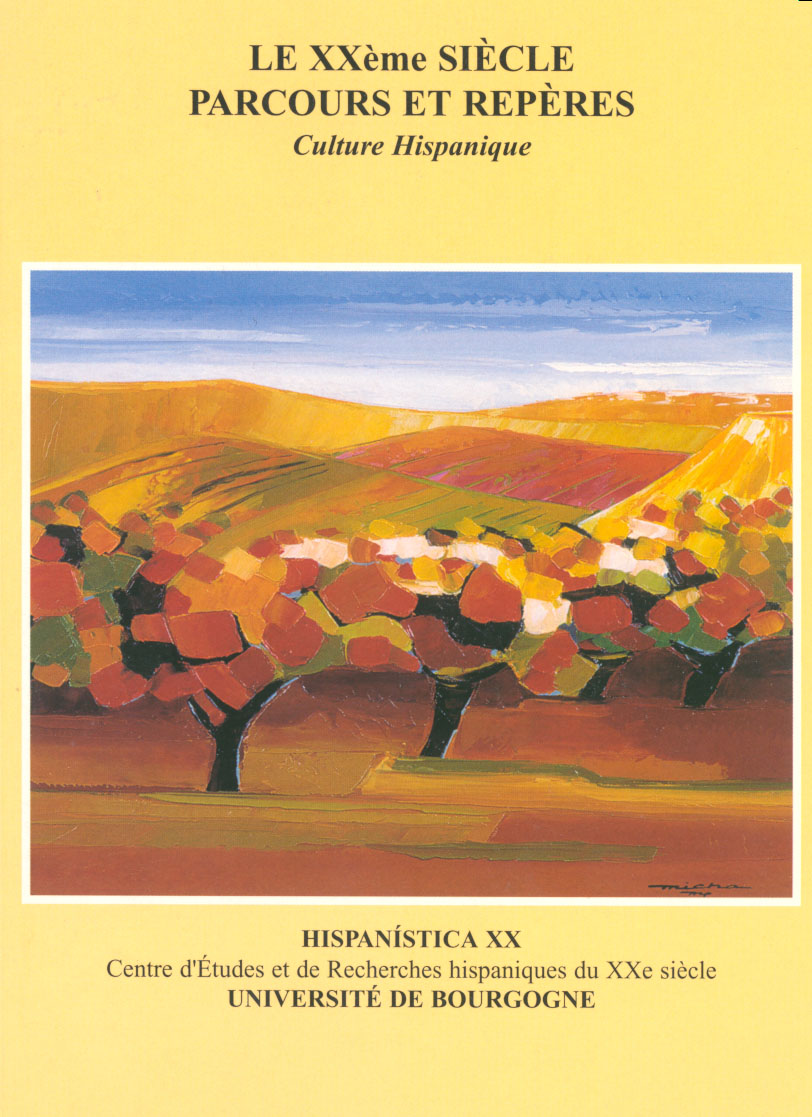Prix : 21 euros + frais postaux
n°17
Sommaire :
María Francisca VILCHES DE FRUTOS : Teatro e Historia : una mutua interrelación en la escena española contemporánea
Dru DOUGHERTY : El estreno de Cuento de Abril (1910). Recepción e Historiografía
Wilfried FLOECK : Dramaturgos españoles contemporáneos como lectores de las crónicas de la conquista : Sanchis Sinisterra y López Mozo
Dorita NOUHAUD : Un épigrafe de quita y pon
Guy THIEBAUT : 1910-1968 -6 juillet 1997 : Histoire revisitée et histore “rêvée” chez P.I. Taibo II
Roselyne MOGIN-MARTIN : La Novela corta de Angeles Villarta (1950 ?) ou l’impossible résurrection d’un genre : la “revista novelera”
Luis IGLESIAS FEIJOO : La tragedia de la Historia : El concierto de San Ovidio, de Antonio Buero Vallejo
Catherine ORSINI : La mise en scène d’une mémoire : Escenas de cine mudo de Julio Llamazares
Angel Luis HUESO MONTÓN : La revisión de la Historia en cine de Jaime Camino
Jean-Paul AUBERT : Les enjeux de la mémoire dans l’oeuvre de Vicente Aranda
Jean-Claude SEGUIN : Du réalisme au naturalisme (1896-1932) (Quelques questions posées au cinéma par Bergson et Deleuze…)
Emmanuel LARRAZ : Cinéma et mémoire : Judíos de patria española (1929) d’Ernesto Giménez Caballero
Jacques SOUBEYROUX : La mise en intrigue de soi dans Recuento de Luis Goystisolo (1973)
Laurence GARINO-ABEL : Instance narrative et quête d’identité : la déclinaison de l’altérité
Pilar NIEVA DE LA PAZ : Modelos femininos e indeterminación de la identitad : Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997), de Lucía Etxebarría , y Atlas de geografía humana (1998), de Almudena Grandes
Eliane LAVAUD-FAGE : Ecriture fragmentaire et identité chez Valle-Inclán
Philippe MERLO : La construction identitaire dans Juegos de la edad tardía de Luis Landero
Silvia LARRAÑAGA-MACHALSKI : La fragata de las máscaras : La selva espesa de la verdad
Caroline DOMINGUES : Entre localisme et universalisme : le cas de l’identité galicienne
Carmen BECERRA SUÁREZ : Memoria, biografía y ficción en Dafne y ensueños de Gonzalo Torrente Ballester
Monique MARTINEZ : Attention , un crime peut en cacher un autre … La problématique du même et de l’autre dans deux monologues de Ernesto Caballero et de Alfonso Zurro
Christian LAGARDE : Quand le même est le même … ou quand prend corps l’altérité
Marco VECCHIA : Refaire sa vie. L’identification publicitaire comme reconstruction autobiographique
Stephen G.H. ROBERTS : El exilio como una experiencia temporal : Miguel de Unamuno y Cómo se hace una novela
Rose DUROUX : Idas y vueltas del siglo
Laureano ROBLES : Primeros ideólogicos del franquismo
Marie-Madeleine GLADIEU : Traditions et idéologies : le triomphe de la barbarie ? Bilan de l’oeuvre romanesque de Mario Vargas Llosa
Jean-Pierre CASTELLANI : Ecrire l’intime : le cas de Francisco Umbral
Eliseo TRENC : Identité et publicité (Les annonces commerciales de quelques communautés de l’Etat espagnol )
Guy ABEL : Traces d’exil et reflets de dictature en bande dessinée : Perramus de Breccia et Sudor sudaca de Muñoz
Didier CORDEROT : La femme au coeur de la guerre civile espagnole : un objet littéraire convoité par les nationalistes
Jean-Pierre RESSOT : Du modernisme au post-modernisme : la traversée du siècle de Ramón J.Sender
José Miguel OLTRA TOMÁS : Breve panorama de las revistas poéticas del siglo XX : un intento de periodización
Nicolas BONNET : Quelques considérations sur les esthétiques de José Ortega y Gasset (1883-1955) et Benedetto Croce (1866-1952)
Marie-Claire ZIMMERMANN : Le parcours du poème et les repères du lecteur
Lire un article
La femme au cœur de la guerre civile espagnole : un objet littéraire convoité par les nationalistes
Didier CORDEROT
Dijon
C’est avec l’avènement de la IIe République, en avril 1931, que les droits de la femme espagnole sont enfin reconnus. L’égalité des sexes, inscrite dans la Constitution, lui donne la possibilité d’accéder à des charges publiques jusqu’alors réservées aux hommes. La loi sur le divorce, datant de février 1932, peut être considérée comme l’une des plus tardives en Europe, mais elle est aussi l’une des plus progressistes et entraîne un profond mécontentement des milieux catholiques. La République ne s’est-elle pas donné pour mission de contrôler le pouvoir de l’Église, dont elle envisage sa séparation de l’État en l’assortissant d’une série de mesures à l’encontre des congrégations religieuses ? Quant au droit de vote des femmes, il est acquis en octobre 1931, bien que les parlementaires de gauche craignent, à juste titre, les conséquences électorales du cléricalisme féminin.
Force est de constater de fait que le conservatisme religieux de la société espagnole va sérieusement remettre en cause le succès de ces réformes. Les députés femmes aux Cortes ne sont qu’au nombre de trois à la fin de l’année 1931, sur un total de 476 sièges : Victoria Kent (Gauche républicaine), Clara Campoamor (Parti radical) et Margarita Nelken (Parti socialiste). Quant aux éventuelles conséquences du droit au divorce, on peut dire qu’elles sont neutralisées par les sermons réactionnaires de prêtres zélés qui brandissent la menace de l’excommunication face à des ouailles féminines que l’analphabétisme maintient souvent dans l’ignorance de leurs droits. Néanmoins, les bases d’une prise de conscience sont jetées et la répression sanglante de la Révolution des Asturies, où les femmes prennent une part active, consolide le processus de leur politisation. Le Groupement des femmes antifascistes (Agrupación de Mujeres Antifascistas), qui bénéficie de l’appui des femmes républicaines et socialistes de la classe moyenne, est créé en 1933 ; le mouvement des Femmes contre la guerre et le fascisme (Mujeres contra la Guerra y el Fascismo), proche du Parti communiste, apparaît un an plus tard, coïncidant de ce fait avec la naissance de la très rétrograde Section féminine de la Phalange. Les femmes anarchistes tardent davantage à mettre en place une structure qui leur soit propre. C’est chose faite en mai 1936, avec l’organisation Femmes libres (Mujeres Libres) qui donnera toute sa mesure avec la guerre civile.
Le conflit de 1936 va en effet constituer un terrain d’expression privilégié pour ces différents mouvements. Chez les républicaines, où prévaut la diversité idéologique, les attitudes sont multiples : engagement armé — citons le cas du bataillon Lina Odena, à la fois composé et dirigé par des femmes —, soutien des soldats du front, participation aux tâches de l’arrière afin de pallier l’absence des hommes, etc… Unies par leur volonté de faire triompher la cause, elles se divisent pourtant sur la question de la révolution sociale que certaines entendent ajourner, alors que d’autres souhaitent sa réalisation immédiate. Dans le camp nationaliste, où le seul discours autorisé émane de la Phalange, Pilar Primo de Rivera, responsable de sa Section féminine, prône une totale soumission de la femme à l’homme et lui dénie toute possibilité de participer au débat politique. Dolores Ibárruri (« La Pasionaria »), Federica Montseny, Margarita Nelken sont quelques-unes des « rouges » dont l’exemple est honni.
Aussi n’y a-t-il rien d’étonnant à ce que l’expression de cet antagonisme radical soit omniprésente dans la presse de l’arrière et plus particulièrement dans les revues culturelles, dont les lecteurs, en raison des circonstances, sont avant tout des lectrices. La nouveauté tient, entre autres, à la place qu’y occupe le double fictionnel de la femme dans de fréquents récits narratifs brefs. Notre propos est de montrer comment, chez les nationalistes, ce pan de la production littéraire, par ailleurs souvent passé sous silence, sert à relayer le discours théorique concernant le rôle et les attributions de la femme, voire à le fonder. Nous serons ainsi conduits à nous demander si cette littérature a l’unique fonction de cristalliser les oppositions et d’en rendre compte ou si elle est également un laboratoire pour les idées « nouvelles ». Au-delà donc de la construction d’archétypes et de la récurrence d’axes fictionnels, dont on ne peut faire l’économie, il faut s’intéresser aux projets de société qui sous-tendent ces textes où la femme est plus que jamais une pierre angulaire. Pour ce faire, nous avons retenu deux publications du camp nationaliste destinées à un public féminin : Mujer et Y.
La première d’entre elles, Mujer, Revista mensual del hogar y de la moda, prolonge une pratique de la revue féminine qui est antérieure à la guerre civile. Elle l’affirme ouvertement en reprenant un titre qui n’est pas nouveau : le plus proche dans le temps est celui d’un hebdomadaire, destiné à la « femme moderne », qui paraît peu après la proclamation de la IIe République. Son contenu féministe et républicain est élaboré par des femmes de renom : Concha Espina — on la retrouve aux côtés des nationalistes pendant la guerre civile —, Margarita Nelken, Carmen de Burgos, Sara Insúa, Matilde Muñoz, etc. Il n’est bien sûr pas question pour la revue publiée à Saint-Sébastien en juin 1937 de revendiquer cet héritage. Elle a d’entrée remis le « sexe faible » à la place qu’il doit tenir dans la société projetée par les nationalistes. Le territoire de la femme est en effet d’abord celui du foyer baigné dans une « quiétude spirituelle » — celle que souhaite apporter la revue. La femme n’est plus concernée par le débat politique et doit s’en remettre totalement à l’arbitrage masculin. Un article intitulé « La femme et les livres » résume parfaitement le rôle qui lui est désormais dévolu :
El principal placer que proporcionan los libros es el de su lectura. Otro, también importante es el de clasificarlos, el de colocarlos debidamente. Una mujer arreglando libros frente a la estantería parece que está arreglando flores con los coloridos distintos de las encuadernaciones que forman una gama que se diría tiene, a la par que tonalidades, perfumes[1].
Les rubriques proposées vont dans le sens de la passivité intellectuelle : actualités cinématographiques, chroniques de mode, patrons de couture, exercices de culture physique… Les contes et nouvelles[2], même si elle en est la principale héroïne, participent de cette mise en retrait de la femme. L’examen des textes qui ont un rapport avec la guerre civile, c’est-à-dire ceux où elle est censée être la plus autonome, ne laisse aucun doute à cet égard.
Dans les onze textes qui sont en phase avec l’affrontement, soit plus d’un tiers de la production narrative de Mujer, le personnage principal est généralement une femme[3]. Elle a entre dix-huit et vingt-cinq ans et appartient la plupart du temps à un milieu social privilégié, ainsi que le soulignent les dessins illustrant chacun des textes et qui la représentent dans une pose toujours très stylisée[4]. Beauté sans égale, elle est à l’origine de l’héroïsme masculin dans le conte d’Agustín de Figueroa[5], Yo sé por qué…, dont l’« hérésie » idéologique est rapidement conjurée. Antonio Villalba, réfugié dans une ambassade étrangère, souhaite en effet que Madrid ne soit pas « libéré » par les troupes nationalistes, afin de pouvoir rester en compagnie de l’inaccessible Alicia. Amoureux transi, il ira mourir sur le front.
Néanmoins, la guerre, traitée comme un élément romanesque à part entière, révèle avant tout une nature profondément compatissante de la femme. Celle-ci la met à profit dans les hôpitaux où on la retrouve fréquemment, revêtue de la blouse d’infirmière, aux côtés de soldats blessés. C’est le cas dans pas moins de cinq textes dont les synopsis précisent l’intention édifiante : Margarita accueille dans une spacieuse villa, qu’elle a transformée en résidence pour aveugles de guerre, son fiancé qui vient de perdre la vue au combat ; elle n’a de cesse de lui montrer que sa passion n’en est pas altérée pour autant. Une autre Margarita — ce nom n’est sans doute pas un hasard puisque c’est celui d’une organisation féminine carliste consacrée aux soins des blessés — dont la vie était jusqu’alors éloignée de l’« Espagne nouvelle, de l’authentique Espagne Impériale qui se dresse sous la protection du joug et des flèches symboliques », donne un sens à son existence insouciante en apportant le réconfort à un soldat grièvement atteint. María Isabel, infirmière dévouée s’il en est, confie aimer un combattant de la « zone rouge », auquel donne la mort un autre prétendant, légitimé par son appartenance aux forces nationalistes. Après avoir abandonné son troupeau de chèvres pour rejoindre un hôpital de fortune, Clara, « miracle d’aristocratie paysanne », déclenche la passion amoureuse d’un capitaine qu’elle sauve grâce au don de son sang ! Le dernier personnage de femme auquel nous avons affaire — il est anonyme — quitte les intrigues de la haute bourgeoisie de Saint-Sébastien pour un hôpital galicien ; elle met ainsi à l’épreuve les sentiments de son mari volage dont le repentir passe par la mort sur le front[6]…
Alors que les rubriques habituelles restent très distantes par rapport aux événements, les textes narratifs n’hésitent pas à relayer les messages nationalistes. Sans oublier leurs destinataires, ils assurent une indiscutable fonction idéologique. La nouvelle, Confesiones de Adela María, présentée comme un journal anonyme commencé en janvier et interrompu au début de la « commotion espagnole », est construite selon ce double principe[7]. De nature à permettre l’identification, les confessions légères de la jeune et riche Adela María, dont la vie se partage entre les sorties mondaines et les projets de mariage, sont encadrées par des considérations pronationalistes. Le soldat qui met la main sur le journal, ex-cadet de l’académie militaire de Tolède, ancien d’Afrique et lecteur impénitent — ne doit-on pas y voir un émule de Franco ? —, dit s’être mis au service de la « Sainte Cause » pour « libérer » l’Espagne des « rouges » dont la brutalité est suggérée par la disparition de l’héroïne. Cette dernière, fidèle à l’image de la femme qui s’en remet à l’autorité masculine, est une farouche contemptrice du féminisme. Elle amplifie les thèses antirépublicaines en donnant à penser, sous le couvert d’une fausse ingénuité, que le Front populaire est une création de l’Union soviétique :
Yo, realmente, no sé para qué sirven las elecciones, porque nada me importa la política, pero veo que aquí han servido para desencadenar un desorden y una barbarie que yo nunca había visto en ningún sitio. Pablo me dice que ese estado de cosas son unos cuantos los que provocan y fomentan. Y son precisamente los que han venido a gobernar a sus satélites que envenenan a las gentes para que conviertan a España en un país como Rusia donde nadie es feliz […].
La passivité de la femme est en fait à replacer dans une perspective idéologique dont les grandes lignes sont empruntées aux textes fondateurs de la Phalange. Elle apparaît dans les fictions comme sentimentalement et intellectuellement dépendante de l’individu masculin. Concha Espina, adepte d’une écriture moralisatrice sur fond de « costumbrismo » narratif, fait sienne cette conception. L’Amelia de sa courte nouvelle, La novia del teniente[8], est la soumission faite femme. Après avoir perdu père et mère, elle ne trouve le réconfort ni chez sa sœur, elle-même victime d’un mari sans principe, ni chez un oncle tuteur où elle est critiquée de tous. La peinture « lacrymogène » de ses déboires, habituels dans les narrations feuilletonesques, sert à donner du relief à sa rencontre avec Luis María, ami d’enfance, devenu héroïque lieutenant de l’armée nationaliste. Leur union est célébrée dans le plus pur style du « roman » à l’eau de rose mais que l’auteur adapte aux circonstances :
Ahora la fidelidad de un alma salvaje los une de pronto en la misma senda, cogidos del brazo, crédulos y sonrientes, llenos de ilusión bajo el estandarte pavoroso de la noche y de la guerra.
Si le stoïcisme est l’apanage d’Amelia Vigil, la patience ne l’est pas moins. Elle devra s’en armer lorsque le lieutenant, rappelé sur le front, prend congé d’elle en lui confiant son chien en gage d’amour et de fidélité…
À l’image d’Amelia, la plupart des femmes rencontrées dans les textes de la revue sont dépositaires des vertus traditionnelles consacrées par la pensée conservatrice du camp nationaliste. Elles n’existent que par la relation qui les subordonne à l’homme et par le regard qu’il pose sur elle. Rien d’étonnant par conséquent à ce que le jury du concours de contes, organisé par la revue en septembre 1938 et réservé à des auteurs féminins, soit composé de trois hommes : Francisco de Cossío, Manuel Gómez Domingo et Mariano Tomás, l’un des collaborateurs les plus réguliers de Mujer. Le succès de ce concours est considérable puisque la rédaction dit avoir retenu quatre-vingt-quatorze textes !
Le premier prix de deux cent cinquante pesetas revient à María Luisa de Macanaz pour A la sombra de la catedral, publié au début de l’année 1939. Carmen, réfugiée en compagnie d’autres femmes dans un monastère de province, apprend, à la lecture d’une revue — son titre nous est familier… —, l’organisation d’un concours de contes auquel elle entend participer. La symbolique du lieu, parfait contrepoint de la République iconoclaste, s’accorde avec l’abnégation du personnage dont le curriculum correspond en tout point à celui du stéréotype féminin de la revue. L’état actuel dans lequel elle se trouve souligne l’anormalité de la situation et plaide pour un retour à la « normale » :
Y allá, en la soledad de su celda [du monastère], fueron pasando su niñez espléndida, su vida de colegiala en el pensionado elegante; más tarde, su entrada en el mundo, las fiestas, los deportes, los viajes. Y más tarde aún, en aquella primavera espléndida de Sevilla, el noviazgo con Luis. Y, ya en crescendo magnífico de su felicidad, la boda en el otoño madrileño[9].
Outre ce premier prix, la revue publie au cours des mois suivants trois des cinq contes à avoir obtenu un accessit[10]. Exception faite de Los disfraces del agua[11], Matrimonio provisional et Polvorilla[12] ont la guerre civile pour toile de fond. Le premier a la particularité rare d’être pris en charge par un homme. Il s’agit d’un diplomate étranger qui propose à une jeune femme, dont les proches parents ont été arrêtés, de fuir Barcelone où règnent le crime et le chaos républicains. Le second met en scène le personnage féminin de Polvorilla qui ne se contente pas d’être une spectactrice des événements comme l’est celui d’Isabel, sa belle-sœur, occupée à broder des flèches — c’est avec le joug l’insigne de la Phalange — sur les chemises bleues de son mari… Après avoir donné des preuves mutiples de son courage, elle tente en vain de sauver son frère de l’exécution puis s’immole à la cause phalangiste dans une voiture lancée à toute allure, au cri d’« ¡Arriba España! » et en exécutant le salut fasciste. Ce texte d’exaltation doctrinaire — on y trouve plusieurs références à l’hymne Cara al sol — est cependant un cas à part dans la production de Mujer, à la fois par sa virulence idéologique peu habituelle, et parce que le modèle féminin qu’il propose est en décalage avec celui jusqu’à présent relevé. En réaction contre les mouvements d’émancipation féminine, dirigés par des femmes honnies dans le camp nationaliste (Victoria Kent, Margarita Nelken, Dolores Ibárruri, Federica Montseny…), les auteurs de Mujer sont partisans d’un statu quo dans la distribution des rôles. En ces temps de guerre, la femme se doit d’être une Pénélope entièrement dévouée au service de l’homme. Le régime franquiste ne fera qu’entériner ce statut :
Amamos a la mujer que nos espera pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y sus rezos[13].
Les textes brefs de Mujer — sans doute en raison de leur importance quantitative — possèdent l’avantage d’avoir clairement investi le cadre de ce que sera l’idéologie franquiste. La nature rétrograde de cette dernière est assumée par des personnages féminins qui, sans le savoir, dessinent la société espagnole de l’après-guerre : les textes narratifs de la revue participent d’un ample projet dont ils renforcent les fondements symboliques par une idéalisation de ses acteurs. Les formes brèves démontrent ainsi une capacité à être autre chose qu’un tribut à acquitter aux autorités nationalistes en échange de l’imprimatur ou un exercice littéraire anodin. Elles le prouvent à nouveau avec la revue Y.
À l’origine de Y, on trouve la Section féminine de la Phalange espagnole traditionaliste (F.E.T. y de las J.O.N.S.), laquelle dispose d’une relative indépendance dans le domaine de la presse et de la propagande. Y, dont le titre fait référence à la reine Isabelle de Castille[14], devenue symbole de la section dirigée par Pilar Primo de Rivera, affiche très tôt son ambition d’être la revue féminine de référence[15]. Pour ce faire, dès son troisième numéro, elle se dépouille d’un sous-titre qui pouvait l’assimiler à une parution confidentielle (Revista de las Mujeres Nacional Sindicalistas) pour devenir la Revista para la Mujer. Dans un même esprit, le volume des articles réservés au Parti unique tend à s’amenuiser au profit de rubriques traditionnelles, propres à lui attirer les sympathies de lectrices qui lui étaient jusqu’alors étrangères. Le message idéologique reste cependant omniprésent. Grâce à un habile parti pris féminin, les collaborateurs de la revue, en majorité des hommes[16], ne manquent pas de reprendre les thèses officielles. C’est ainsi, qu’entre autres, Edgar Neville, Felipe Ximénez de Sandoval ou Jacinto Miquelarena encensent la femme nationaliste tout en rappelant les ambitions totalitaires de la Phalange. Les hommages à son fondateur sont d’ailleurs multiples et favorisent un ton intimiste en accord avec la ligne de la revue : José María Salaverría évoque une entrevue chaleureuse avec José Antonio Primo de Rivera, Agustín de Foxá en parle comme d’un ami et Samuel Ros se souvient de ses rencontres avec lui dans le bar madrilène La Ballena Alegre, centre névralgique de l’organisation avant la guerre[17]. Quant à sa sœur, Pilar Primo de Rivera, elle retrace au cours des seize premiers numéros l’histoire de la Section féminine dont elle est, depuis juin 1934, la première responsable[18].
Y prétend offrir des points de repère dans la formation des femmes en mettant en œuvre les principes définis par José Antonio Primo de Rivera. Celui-ci considère qu’étant donné « l’égoïsme torrentiel » de l’homme, la femme doit se résoudre à « accepter une vie de soumission »[19]. Dans le premier éditorial de la revue, il est clairement établi que la femme, gardienne du foyer entourée de sa progéniture, doit « accomplir une mission de compagnie, d’amoureux complément et d’intégration de l’homme »[20]. S’il est fait mention de ses préoccupations dans la rubrique « ¿Qué duda tienes? », elles ne concernent que ses problèmes sentimentaux, la tache d’encre rebelle sur le corsage, la température idéale du four pour les desserts, les remèdes contre la chute des sourcils ou le duvet inesthétique…
La revue se donne clairement pour but de fournir aux femmes une idéologie pratique, susceptible de les préparer à des temps d’austérité, tout en les tenant éloignées de la politique. Pilar Primo de Rivera[21] veille donc jalousement sur l’héritage spirituel de son frère. Les reportages sur les différentes activités de sa section (Auxilio Social, Frentes y Hospitales…) insistent sur les qualités féminines de sacrifice, de charité, d’humilité et de courage au service de l’homme[22].
Les récits brefs, principalement ceux qui traitent du conflit, servent à renforcer une conception antiféministe du rôle de la femme. La casa muerta[23] de la prolifique Concha Espina[24] lui assigne une fonction d’épouse obéissante et soumise : María Luisa, qui s’apprête à abandonner sa maison pour se réfugier dans une ambassade, est incapable d’initiative personnelle ; elle s’en remet entièrement à son mari, un activiste phalangiste. Elle est aussi et surtout une mère attentive, comparée avec emphase à la Vierge, qui protège un fils symboliquement prénommé José Antonio ! Une fois en sûreté grâce aux autorités allemandes — l’auteur leur voue une profonde admiration —, elle devient une parfaite Pénélope qui brode l’insigne phalangiste sur les chemises bleues de son époux, devenu combattant sur le front d’Aragon. Dans Recuerdo de aquellas horas[25] — titre qui souligne la proximité de la victoire —, Ana María Tollastres fait de la femme une vestale de la religion catholique, capable d’improviser un confessionnal au moyen d’un dossier de chaise. Le texte laisse augurer un nouveau culte consacré aux valeurs domestiques dont la femme se doit aussi d’être la gardienne zélée :
Y aquella habitación se transformó en un templo y aquel tocador en un altar y una polvera chiquitita de señora fue el copón.
L’idéalisation de la femme, à laquelle ne sont pas étrangers les illustrateurs (Aróztegui, María Claret, « Usa », Carlos Sáenz de Tejada…) qui la représentent toujours dans une mise impeccable, n’est pas démentie lorsqu’elle est infirmière. Cette fonction, l’une des rares qu’elle soit en droit d’exercer, n’est que transitoire et motivée par des circonstances exceptionnelles. La jeune phalangiste de Porque lo quiso Dios de Gracián Quijano[26] n’a renoncé aux plaisirs du cinéma, du tennis, de la natation, des concerts ou de la coquetterie, que parce que la situation l’exigeait — elle n’en oublie pas pour autant ses rêves de mariage. À la fois peintre, graveur[27] et écrivain, Ricardo Baroja, le frère de Pío Baroja, semble même voir dans cet emploi le remède efficace pour lutter contre la vanité féminine. Palinodia[28] — la palinodie est adressée par un vieux garçon à sa nièce sous la forme d’une lettre — montre comment une oie blanche (la nièce en question) est capable de se métamorphoser en une infirmière responsable.
Une autre activité exercée dans le cadre de la Section féminine trouve un écho narratif dans Y. Il s’agit de la participation des femmes et des filles de la bonne société aux œuvres sociales de l’Auxilio de Invierno et plus particulièrement aux collectes qui sont faites en son nom[29]. Tomaduras de pelo, le texte de Federico de Madrid[30], présente la particularité de rompre avec la version « consensuelle » du don et avec l’image habituellement effacée de la femme. Dans ce récit, un « commando » de jeunes filles, qui œuvrent pour l’Auxilio de Invierno, obtient par la menace un don considérable d’une riche veuve qui s’était jusqu’alors contentée d’aumônes ridicules. L’auteur ne manque pas de tirer de cette histoire une morale qui cautionne le procédé utilisé :
Y he aquí cómo la patriótica y caritativa agresividad de aquellas muchachitas obtuvo de un golpe muchas hogazas de pan para los niños hambrientos y por feliz carambola, muchas prendas de abrigo para los hombres del frente.
Ce récit laisse affleurer une conception plus volontariste de la femme que défend au sein de la Phalange la veuve d’Onésimo Redondo[31], Mercedes Sanz Bachiller. En s’inspirant de l’exemple nazi, elle revendique un embrigadement de la femme qui se concrétise par l’organisation, avec Javier Martínez Bedoya, de l’Auxilio de Invierno[32], puis du Servicio Social de la Mujer. Sa rivale, Pilar Primo de Rivera, pense au contraire que la « régénération féminine » passe par un retour au foyer. Franco lui donnera raison[33].
La revue Y, à l’image du mouvement dont elle est l’expression, prêche une soumission sociale des femmes qui va servir de base à la société franquiste. En règle générale, ce que mettent en évidence les textes narratifs, c’est que leur activisme social est avant tout dû aux circonstances et doit prendre fin avec le retour de la paix : les récits brefs participent à la mise en place d’un type féminin qui prend délibérément le contre-pied de celui qu’avait esquissé la République. Les femmes qui ont renoncé à s’émanciper n’aspireraient qu’à retrouver les joies du foyer, les rires de leurs enfants et les conseils de leur mari… Y constitue ainsi un rouage important de l’appareil de presse et de propagande de la Phalange unifiée qui répond à la volonté d’asseoir l’emprise des idées du parti auprès d’un public féminin sciemment « ciblé » et susceptible d’en être ensuite le vecteur.
Pour reprendre l’expression de l’écrivain Enrique Jardiel Poncela, fervent défenseur de la cause nationaliste, on peut dire que les textes narratifs présents dans Mujer et Y, érigent en modèle la « femme bleue »[34], c’est-à-dire « celle qui est féminine sans être féministe ; celle qui prie et raisonne ; celle qui sait être à la maison et marcher dans la rue ; celle qui connaît ses horizons mais n’ignore pas ses limites » ou encore « celle qui a appris que la véritable indépendance c’est de dépendre de tout » ! Pilar Primo de Rivera, leur chef de file, n’est-elle pas convaincue que les femmes ne découvrent jamais rien car c’est aux hommes que Dieu a réservé cette tâche ? Elles devront donc se contenter de procréer et de veiller à la bonne marche de leur foyer. Après la victoire nationaliste, par une ironie de l’histoire, le club Medina de la Phalange investit les locaux du Lyceum club de Madrid. Là où toutes les questions concernant l’égalité des sexes avaient été abordées, et ce dès les années vingt, on donnera désormais des cours de religion, de morale, de national-syndicalisme, de confection, d’économie domestique, de gymnastique et de puériculture[35] !
[1] Mujer, n°18, XI/1938, p. 29. On notera que l’auteur anonyme de l’article prend le soin de sélectionner les ouvrages puisque figurent en bonne place un livre de Pío Baroja, écrivain récupéré par les nationalistes, et De Corte a checa d’Agustín de Foxá dont le parti pris est lui sans équivoque.
[2] Leur publication est très régulière puisque seul le n° 6 n’en contient pas.
[3] Il convient de remarquer que les textes de Tomás Borrás ou de José María Salaverría, auteurs qui en d’autres endroits clament haut et fort leur appartenance au camp nationaliste, sont neutres. La neutralité narrative de Pío Baroja est quant à elle sans surprise.
[4] Les auteurs de ces dessins sont entre autres Baldrich et Teodoro Delgado. Carlos Sáenz de Tejada illustre un texte sans rapport avec la guerre civile : La señorita Cirano de Javier Machado (Mujer n° 8, I/1938).
[5] Agustín de Figueroa y Alonso, Marquis de Santo Floro, fils du Comte de Romanones – ce dernier fut chef du gouvernement et du Congrès avant la guerre et soutint les forces nationalistes durant celle-ci – est l’auteur d’un livre sur sa captivité dans le camp républicain intitulé Memorias del recluso Figueroa (Saragosse, Librería General, 1938). Il est de plus un collaborateur assidu de la presse nationaliste (Domingo, El Diario Vasco, Vértice, Horizonte…).
[6] Successivement Javier Machado, La tapia (Mujer n° 2, VII/1937) ; María Dolores Fernández, Margarita (Mujer n° 11, IV/1938) ; M. Fernández Palacios, María Isabel (Mujer n° 4, IX/1937) ; Josefina de la Maza, Licor de bodas (Mujer n° 19, XII/1938) ; P. Vila San-Juan, Una mujer especial (Mujer n° 12, V/1938).
[7] Sa publication dans Mujer occupe cinq numéros (du n° 17 au n° 21).
[8] Mujer n° 13, VI/1938 ; n° 14, VII/1938 ; n° 15, VIII/1938 et n° 16, IX/1938.
[9] Mujer n° 20, I/1939.
[10] Nous n’avons pas trouvé de traces de Soledad de Gracián Quijano ni de La madrina fea de Nena Agea Jorge Saiz de Bustamante.
[11] Felicidad R. Serrano, Los disfraces del agua (Mujer n° 21, II/1939). Faut-il voir cependant dans l’allusion à une eau qui « marche d’un pas triomphal » une métaphore des victoires successives des troupes nationalistes ? Aucun autre élément du texte ne permet d’étayer ou d’infirmer cette proposition.
[12] Juana de Collantes, Matrimonio provisional (Mujer n° 22, III ou IV/1939) ; Paz Ferreiros, Polvorilla (Mujer n° 23, V/1939).
[13] Éditorial de la revue Medina (20/III/1941) cité par Carmen Martín Gaite, in Usos amorosos de la postguerra española, Barcelone, Editorial Anagrama, 1994, pp. 71-72.
[14] Le « Y » était au XVe siècle la première lettre du nom d’Isabelle de Castille. Les Rois Catholiques, auxquels la Phalange a emprunté son symbole du joug et des flèches, deviennent dans la rhétorique politique le modèle politique incontournable et sont une constante dans les programmes d’éducation. Réalisateurs de l’unité nationale, ils permettent également de réaviver l’antisémitisme. Cf. Esther Martínez Tórtola, La enseñanza de la historia en el primer bachillerato franquista (1938-1953), Madrid, Tecnos, 1996, p. 73.
[15] Y est proche dans sa conception de Vértice, mais elle est d’un coût inférieur ; cf. Marie-Aline Barrachina, « De Y, Revista de las mujeres nacional sindicalistas à Y, Revista para la Mujer », in Danièle Bussy Genevois (dir.), Typologie de la presse hispanique, Rennes, Presses Universitaires Rennes 2, 1986, pp. 141-149. L’auteur de l’article souligne l’emploi commun du papier glacé et du papier couché ainsi que la similitude de la composition typographique.
[16] Journalistes, écrivains ou dessinateurs, ils sont presque tous issus de l’équipe de Vértice.
[17] Y n° 10, XI/1938, numéro spécial consacré à José Antonio Primo de Rivera. Selon Samuel Ros, qui manie l’emphase, « En el vientre de “La Ballena” se forjaba el gran estilo de la intransigencia que hoy encontramos convertida en la espada de Franco. » Parmi ses assidus on trouve Eugenio Montes, Jacinto Miquelarena, Luis Bolarque, Luis Peláez, Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo, Víctor et Luis de la Serna, Javier de Salas, Antonio de Obregón, Juan Cabanas ou Juan Antonio de Zunzunegui.
[18] Le rôle de ces premières phalangistes consistait principalement à aider par des collectes les membres du parti en prison ou, le cas échéant, les familles de ceux qui étaient morts dans des affrontements de rue. Cf. Paul Preston, Las tres Españas del 36, Barcelone, Plaza Janés, 1998, pp. 143-176.
[19] Ce sont quelques-uns des termes qu’il emploie le 28 avril 1935 dans une déclaration à une trentaine d’adeptes féminines : « El hombre –siento, muchachas, contribuir con esta confesión a rebajar un poco el pedestal donde acaso le teníais puesto– es torrencialmente egoísta; en cambio, la mujer casi siempre acepta una vida de sumisión, de ofrenda abnegada a una tarea », in Paul Preston, Las tres Españas del 36, op. cit.
[20] Y n° 1, II/1938, p. 2. Les femmes qui font de la politique sont les « têtes de turc » de la revue. À titre d’exemple, l’article d’Edgar Neville au sujet de Margarita Nelken s’intitule « Margarita Nelken o la maldad » (Y n° 8, IX/1938).
[21] Pilar Primo de Rivera conservera son poste de déléguée nationale de la Section féminine jusqu’à la dissolution des organes du Mouvement en 1976.
[22] N’apprend-t-on pas qu’un grand nombre d’entre elles ont été « poursuivies par la tyrannie rouge » et qu’elles ont séjourné dans des cachots où elles ont appris à ne plus avoir peur des rats ou des souris ? (Luis de la Barga, « Intimidades de la guerra: ratas y ratones », in Y n° 11, XII/1938).
[23] Y n° 3, IV/1938. Ce texte est repris dans un recueil intitulé El fraile menor (Cuentos), Madrid, Gráfica Informaciones, 1942.
[24] Pendant la guerre, elle écrit dans de nombreuses revues nationalistes – quelques-unes de ses nouvelles sont reprises dans Luna roja. Novelas de la Revolución, Valladolid, Librería Santarén, 1939 – et publie plusieurs romans, ainsi qu’un journal, tous en prise avec le conflit : Retaguardia. Imágenes de vivos y muertos, Saint-Sébastien, Librería Internacional, 1937 ; Las alas invencibles. Novela de amores, de aviación y de libertad, Burgos, Imprenta Aldecoa, 1938 ; Princesas del martirio, Barcelone, Ediciones Armiño, 1939 ; Esclavitud y Libertad. Diario de una prisionera, Valladolid, Ediciones Reconquista, 1938.
[25] Y n° 14, III/1939.
[26] Y n° 4, V/1938.
[27] Il est l’auteur de Croquis de guerre, qui ne sont pas sans rappeler les Désastres de la guerre de Goya.
[28] Y n° 6-7, VII-VIII/1938.
[29] Cf. María Teresa Gallego Méndez, Mujer, Falange y Franquismo, Madrid, Taurus, 1983.
[30] Y n° 15, IV/1939.
[31] Il est avec Ramiro Ledesma Ramos le fondateur des J.O.N.S.
[32] Fondé à la fin du mois d’octobre 1936, l’Auxilio de Invierno (orphelinats, centres d’accueil pour les veuves, cantines…) est rebaptisé, en mai 1937, Auxilio Social. En octobre 1937, selon Hugh Thomas (La Guerre d’Espagne, op. cit., p. 837), « Auxilio de Invierno comptait 711 maisons, en octobre 1938, 1 265, et en octobre 1939, 2 887 ». L’exemple de l’Auxilio de Invierno est à l’origine d’autres organismes dont les Cocinas de la Hermandad. Les Margaritas, organisation carliste féminine, ne furent pas non plus en reste dans le domaine social.
[33] Mercedes Sanz Bachiller tombera temporairement en disgrâce. Outre les raisons politiques, il semble que son remariage avec Javier Martínez Bedoya ait fait définitivement pencher la balance en faveur de Pilar Primo de Rivera. Elle fut destituée par Serrano Suñer de son poste de déléguée nationale de l’Auxilio Social au motif de malversations… Le même Serrano Suñer lui confie en 1942 un poste à l’Institut national de prévision qui s’occupe alors d’une fantomatique sécurité sociale.
[34] Enrique Jardiel Poncela, « Mujeres verdes, mujeres rojas, mujeres lilas, mujeres grises, Mujeres Azules », in Y n° 6-7, VII-VIII/1938. L’article est reproduit dans sa totalité par Marie-Aline Barrachina, Propagande et culture dans l’Espagne franquiste 1936-1945, Grenoble, Ellug, 1998, pp. 237-241. Parmi les « femmes vertes », on trouve entre autres des « voyageuses, blondes, de transatlantiques et d’express », des « divorcées de maris inconnus », des « femmes de théâtre, de cinéma », des « étoiles de variétés »… La catégorie des « femmes rouges » concerne évidemment toutes les femmes qui ont une activté politique ou qui auraient l’intention de s’émanciper… Le groupe des « femmes lilas » est constitué d’« étudiantes universitaires de la F.U.E. » [syndicat universitaire de gauche], de « féministes », de « pédantes et autres femmes savantes », de « républicaines par admiration pour le talent et la beauté d’Azaña » ! Le quatrième est celui des « femmes grises », c’est-à-dire des « lectrices de romans à l’eau de rose », des « fatalistes », des « femmes sans cervelle »… Le dernier groupe étant celui des « femmes bleues » qui a toute la sympathie de l’auteur.
[35] Cf. Isaías Lafuente, Tiempos de hambre. Viaje a la España de posguerra, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 86.