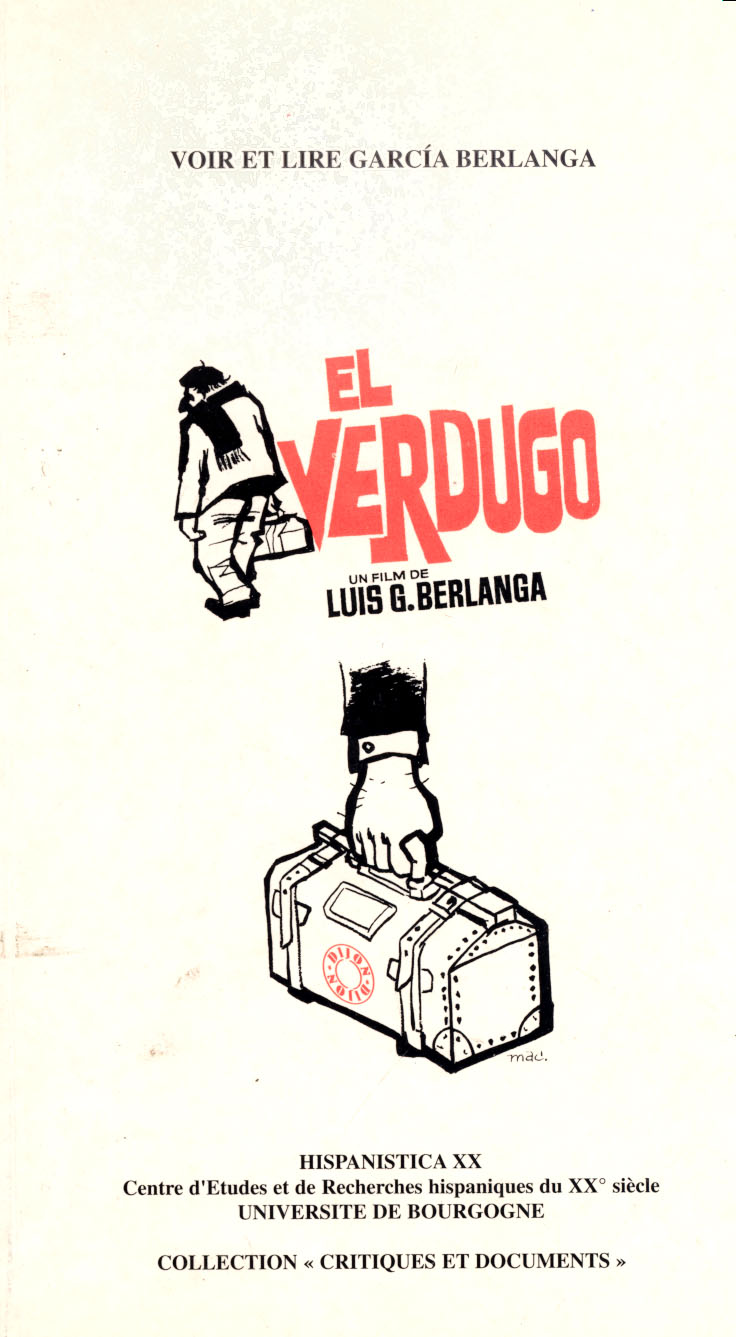Prix : 11,43 euros + frais postaux
Sommaire :
Angel Luis HUESO MONTÓN : Un período en el cine español : el cruce de las tendencias
Emmanuel LARRAZ : L’humour macabre de Luis García Berlanga
Pilar MARTINEZ-VASSEUR : Le contexte historique de El verdugo : Libéralisation, développement et garrot
Nancy BERTHIER : Prénom Carmen (Images de la femme dans El verdugo)
Carlos SERRANO : De un verdugo a otro
André GARDIES : La mise en scène narrative de l’espace
Bernard GILLE : El Verdugo : l’écho viscéral du rire et de la mort
Emmanuel LARRAZ et Carlos SERRANO : Documents : El verdugo et la censure
Lire un article
El Verdugo : l’écho viscéral du rire et de la mort
Bernard GILLE
Université Paris IV
L’oreille humaine est habituée à distinguer d’une part,
la voix et la musique qui con-stituent la base des sons
agréables à écouter ; d’autre part, le bruit que, souvent,
on cherche à éviter.
J.J. Matras, Le son, Que sais-je, 293.
Le tableau des occurrences sonores qui nous servira de référence ne prétend pas être un relevé complet d’une audition acoustiquement controlée de la bande-son. Il n’est que la notation d’une écoute avec tous les mirages, les décodages impatients, les refoulements qu’implique le filtrage subjectif des perceptions lorsqu’elles deviennent des sensations qui finissent elles-mêmes par se prendre pour des « idées ». Il nous a cependant paru indispensable pour la prise en compte des caractéristiques et de la fonction à la fois spécifique et complémentaire de la bande-son dans le montage audio-visuel. On trouvera ici un complément aux précieuses indications du découpage de l’Avant-Scène [1] établi à partir de la copie de référence pour l’épreuve orale du CAPES. La video Mercury gomme une part importante des messages auditifs et, pour remédier à cette perte de relief et de perspective sonore, nous avons eu recours à une version de El Verdugo diffusée par la télévision française qui n’aurait pu être proposée à des étudiants hispanistes en raison d’un sous-titrage intempestif, au demeurant fort réjouissant.
Ce tableau est destiné à visualiser le mixage des bruitages et des musiques du film pour les confronter, dans certaines séquences, au montage ou au dialogue quand celui-ci apporte une indispensable précision. Les symboles qui figurent en tête du tableau sont destinés à signaler les variations du volume sonore dans les attaques de séquence, l’intensité de certains messages intermédiaires, et, en particulier, leur passage arbitraire en premier plan sonore ou leur présence soudainement estompée, ceci pour nous mettre en garde contre l’illusion référentielle et nous convaincre de la non-mimétique nature du son au cinéma, même dans un film dit « réaliste ». Berlanga pratiquant la post-synchronisation, il faut parler de bruitages et non de bruits. Si on excepte les ambiances ou les sons synchrones avec les déplacements ou les actions non particularisées des personnages, on constatera que les sources enregistrées ont été non seulement amplifiées, reverbérées, atténuées, mais qu’elles sont parfois le résultat d’une re-composition artificielle qui en souligne l’expressivité. La différence entre musique et bruit n’est plus alors aussi marquée et nous tenterons de montrer le rôle joué dans El Verdugo par cette orchestration des bruitages.
Hormis l’accompagnement du générique et le twist final de Adolfo Waitzman, il n’y a pas, dans El Verdugo, de « musique de film ». Miguel Asins Arbó n’a pas écrit une partition ordonnant de manière recurrente les péripéties de l’action. Les thèmes musicaux sont des adaptations, réductions ou arrangements de citations, musiques d’emprunt institutionnelles ou ritualisées (Marche nuptiale, pl. 64, Barcarolle, pl. 136-145) et standard de jazz adapté pour les variétés (Petite Fleur). Ce codage convenu permet de les intégrer en toute vraisemblance à la banalité des circonstances qu’elles accompagnent. En conséquence, et à la seule exception cette fois du générique, le spectateur peut en déterminer la source sonore, qu’elle soit située explicitement dans le champ ou dans un hors-champ contigu vraisemblable. Petite fleur est diffusé par le transistor du couple grincheux, la Marche nuptiale par l’orgue de l’église et la Barcarolle par un quatuor fort logiquement « embarqué » qui passe du in au off selon les besoins de l’action. Les autres musiques épisodiques sont jouées en direct par des fanfares, à l’arrivée du ferry, ou diffusées par des hauts-parleurs dont l’image est parfois montrée en premier plan. L’improvisation des employés des Pompes Funèbres est également tournée — sinon enregistrée — en direct. Le twist final est diffusé par la radio du canot à moteur. Ce choix de la « musique d’écran » renforce le parti-pris de renoncer à l’irréalité des musiques de fosse[2].
L’examen global de la bande-son que nous souhaitons présenter ne permet pas d’analyser chacune des occurrences musicales comme il faudrait le faire dans l’étude d’une séquence particulière. Nous nous contenterons de restituer à chacune des musiques sa fonction spécifique dans la construction de la fiction, dans l’orientation thématique et dans les références à un système de valeurs qui fonde le rire et, par conséquent, la morale du film de Rafael Azcona, de García Berlanga sans oublier le musicien Miguel Asins Arbó.
Il va de soi que la musique, même dans cette fonction ancillaire qui lui est dévolue au cinéma, conserve son inaliénable appartenance à un code culturel spécifique, ce qui la maintiendra toujours à distance de la fiction. Distance qu’il ne faudrait pas confondre avec un effet de distanciation systématique. Dans el Verdugo le tableau fait apparaître cette intégration, d’ordinaire discrètement vraisemblable, ce qui ne donne que plus de relief aux situations du film où la musique passe en premier plan sonore, pour souligner la conclusion d’une séquence et enrichir sa signification par l’émergence quasi autonome des codes musicaux. L’exemple le plus notable nous paraît se situer à la fin de la première séquence, quand « monte » la voix du cantaor gitan
(pl. 22) mais, sans créer un tel climat tragique, l’improvisation des employés des Pompes Funèbres (pl. 63) et surtout le twist final, dont on amplifie le volume alors que la barque qui le diffuse s’éloigne, illustrent aussi cet effet d’emphase conclusif qui rompt avec la vraisemblance du réel pour mieux proclamer une vérité.
L’amplification du volume sonore n’est pas la seule intervention qui tende à détourner la musique d’écran de son habituel ancrage référentiel. Sans artifice technique, tout en gardant à leur source sonore une basse intensité continue qui les cantonne au second plan, certaines occurrences gagnent une valeur ajoutée de commentaire de la situation à laquelle elles s’intègrent. Nous reviendrons sur la barcarolle de la Cueva del Drach, très assourdie et lointaine. Moins complexe dans leurs connotations culturelles, les deux interventions du cornet à pistons commentent la rencontre entre Carmen et José Luis (plans 27-29-36) puis leursamours (plan 56) avec l’ironie propre à cet instrument dans la tradition du vaudeville troupier ou courtelinesque. Mais le cornet, après les exercices, passe à l’exécution d’une mélodie mélancolique (plans 56-57) lorsque la scène prend un tour mélodramatique et plus profond. Malgré tout, la tradition du género chico et du vaudeville réapparaît en fin de séquence lorsque José Luis, demandant la main de Carmen, perd son pantalon. Le timbre et la volubilité codés de l’instrument ont discrètement participé à la tonalité humoristique qui préside à la constitution du couple protagoniste, tout en introduisant assez de générosité, de compassion dans le point de vue de ce cornettiste, devenu narrateur à son insu, pour que la dérision ne conduise pas à la caricature et à la déshumanisation. Tout l’enjeu du film est dans le maintien du périlleux équilibre entre comique et tragique, qui ne s’obtient qu’au prix du renoncement aux facilités et conventions de la comédie cinématographique des pays latins, et, surtout, des variations hispaniques sur le genre. Miguel Asins Arbó a dû se plier aux exigences du scènario d’Azcona. Sa musique en a été préservée de tout poncif.
Les musiques d’écran du Verdugo sont partie intégrante du processus narratif. En conséquence elles auraient pu se contenter de suivre et de souligner les étapes d’un mélodrame costumbrista ou neo-réaliste. Lancée par un générique (« sarcastique », l’histoire d’amour née d’une rencontre fortuite (boy meets girl), continuée par un flirt (redondante Petite Fleur pl. 48) aboutit à une « liaison » dont le fruit est accepté, non sans réticences, par le « vil séducteur ». Celui-ci répare ses torts, aux accents d’une improvisation du « Undertaker’s band ». Un pauvre mariage religieux, sans Marche Nuptiale, régularise la situation. Le couple connaîtrait alors ces moments de fête qui ne peuvent manquer dans un film populiste. Même les pauvres partent en voyage de noces, même s’ils le font en léger différé, mais qu’importe puisqu’ils sont bercés par la Barcarolle d’Offenbach. Le temps ne suspend pas son vol, le bonheur tombe dans le lac. On aurait alors le dénouement doux-amer, désenchanté, des comédies néo-réalistes revisitées par Fellini dans les années 60, avec, en prime, la petite note sociale. Les passagers de l’entrepont voient s’éloigner la jet set vers les « villas de rêve » qu’ils ne verront, eux, que dans Hola! Mais il manque alors dans El Verdugo « un petit thème plein d’espoir » qui ferait briller malgré tout un peu de lumière / dans les yeux des prolétaires, sur la surimpression en travelling d’une « Fin » très ouverte. Dans les années 60, cet argument romanesque et cette poésie du peuple ne sont plus de mise en Espagne et Berlanga partage, sans renoncer à l’esthétique du réalisme et, par conséquent, sans provocation formaliste, la vision que Martín Santos vient de donner de l’Espagne dans Tiempo de silencio.
La pareja feliz de 1952 entre dans ce temps de silence. A la fin du Verdugo le twist tord le cou à l’espoir parce que le scènario d’Azcona n’est pas régi par les combinatoires alambiquées chères aux narratologues mais par l’élémentaire logique d’une fable. Fable plus proche, dans sa lucidité, de La Fontaine que de Brecht : le bourreau, sa fille et le croque-mort. Si on n’y prend garde, cet argument risque de conduire au burlesque baroquisant des collaborateurs de la Codorniz ou au grotesque esperpentique.
Asins Arbó, en totale complicité avec le projet d’Azcona et Berlanga[3] a sa part dans la transmission par la musique de l’univers clos, limité, aliéné, dans lequel tentent de vivre les protagonistes du Verdugo. Le générique reste en suspens sur un accord de résolution tenu, avec entrée progressive et en canon de tous les instruments dans le style du jazz américain des années 50. Aucun des thèmes musicaux d’emprunt ne va à son terme. Petite fleur est confisqué par le couple grincheux, la Marche nuptiale l’est aussi, dès la sortie du « grand mariage », sur l’ordre d’un sacristain qui n’a pas un regard pour la noce de José Luis et Carmen. Trois accords désinvoltes soulignent cet inachèvement. Encore plus brutale est la rupture pour la Barcarolle qui, par l’effet du montage cut, est littéralement strangulée par l’image et le bruitage du garrot monté dans la cour de la prison. L’interruption des musiques associées à des moments heureux de la vie d’un couple complètent métaphoriquement les représentations d’une frustration ou d’une aliènation dont le spectateur est beaucoup plus conscient que les personnages qui semblent vivre ces moments avec une apparente indifférence, exceptée, bien entendu, l’angoissante situation de la Cueva del Drach. L’humour avec lequel Asins Arbó nous fait participer à la grisaille de la vie ne repose pas sur le seul procédé de l’interruption. Il nous suggère cette médiocrité des illusions perdues par le traitement imposé aux musiques originales.
Michel Chion a remarqué que pour accentuer l’effet de réel dans les musiques d’écran, les ingénieurs du son mettent « en évidence l’infirmité matérielle du corps sonore »[4]. La mélodie créée en 1952 par Sydney Bechet, Petite Fleur[5], devient slow pour thé dansant, diffusé par un transistor de basse fidélité, parasité de surcroît par la radio de la guinguette dont le haut-parleur transmet des slogans publicitaires. Le mauvais traitement du thème est bien sûr à son comble lorsque José Luis, avec une justesse très approximative, siffle la mélodie pour prolonger l’occasion de ce flirt, de ce petit bonheur qui lui a été confisqué. Le texte dialogué confirme l’éxecution brutale, mécanique, de la Marche Nuptiale par un organiste aussi fatigué que son instrument[6]. Asins Arbó, après beaucoup d’autres, assassine la délicate musique de Mendelssonhn pour Le songe d’une nuit d’été, mais il le fait ici pour introduire au mariage expédié de José Luis et Carmen, et cette version désinvolte d’un topique ressassé s’accorde au ton satirique de cette célèbre scène. Beaucoup plus subtil est le traitement de la Barcarolle des contes d’Hoffmann. La partition originale est écrite pour orchestre symphonique et deux chanteurs[7]. Asins Arbó la réduit pour quatuor. Les musiciens jouent de façon routinière cette version flottante, dans un son et lumière plutôt ringard qui affadit, avec l’aide de cette scie pour lunes de miel et émois amoureux la splendeur du lieu naturel. Tout commence dans la dérision, la musique restant à l’arrière-plan, avec la connotation érotico-matrimoniale que l’exploitation, touristique lui a imposé à Venise comme à Ibiza[8]. L’appel du garde civil, reverbéré avec vraisemblance par la voute de la grotte, passe progressivement en premier plan sonore alors que le volume du quatuor reste immuable et son timbre très assourdi. Le renversement de la perspective auditive coïncide avec les images alternées de José Luis et du garde, messager puis nocher de la barque qui le conduira vers son destin. L’irruption de la mort rend au lieu sa splendeur tellurique, mythique. La Barcarolle retrouve, sans que les musiciens forcent leur talent, un peu de l’esprit dans lequel Offenbach, au seuil de la mort, a écrit cet Opéra fantastique, précision apportée en tête de la première édition.
L’examen du lamento gitan a été volontairement différé en raison du contexte où s’inscrit sa particularité. Chanté par Agustín González, acteur du film, il appartient aux musiques d’écran par son intégration vraisemblable à cette aube tragique de l’exécution d’un condamné. L’improvisation , dans le plus pur style du cante jondo, lui épargne l’intervention volontairement réductrice du musicien du film. En dépit du parasitage par le bruitage de la prison[9], de disparitions suivies de résurgences, il s’impose de manière arbitraire et significative à la fin de la séquence. Le tableau met en valeur le contrepoint qui s’établit dans ce début de film, entre musique et bruitage dont il est temps d’aborder brièvement l’organisation polyphonique. Le plan 20 marque la première occurrence du maletín qui structure l’univers sonore du film et participe à la construction de la fiction.
De même que la musique du générique trouve son écho dans le twist final, le bruitage du maletín encadre le récit de la destinée de José Luis, les plans 20 à 27 renvoyant aux deux plans conclusifs, 160-161. Le parallèle entre les séquences s’établit à partir de l’identité de traitement sonore de la mallette. Il faudrait ici faire état d’une étude acoustique pour déterminer les composantes de ce bruitage, établir sa fréquence, sa hauteur, son timbre. Même s’il s’agit d’une échappatoire métaphorique doublée d’un emprunt à peine légitime à la terminologie de la musique contemporaine, nous pourrions dire que le maletín sonne comme un « cluster », agrégat compact de sons qui projette en premier plan sonore le contenu caché d’un bagage, immédiatement désigné comme l’instrument de l’exécuteur. Le garrot dont la matérialisation formelle est différée sera désormais associé a ce bruit de ferraille qui éveille dans l’imagination du spectateur, laissée libre par le flou de la sensation auditive , des représentations plus effrayantes que l’image concrète de l’instrument de mort.
Le bagage d’Amadeo qui, au plan 20, a été posé hors champ sur la table du gardien sans aucun signal sonore, apparaît, découvert par le mouvement du panoramique, en premier plan , muet, objet parmi d’autres. Lorsque, sur l’injonction du fonctionnaire, Amadeo enlève le maletín pour le transférer sur une autre table, la première occurrence de ce que nous avons qualifié de « cluster » se produit. Ce passage arbitraire du silence absolu au bruitage aggressif marquera ses apparitions, avec des sonorisations intermédiaires que nous avons soulignées dans le tableau en faisant figurer le bagage du bourreau en caractères gras. On constate que le maletín, transporté par José Luis (plan 24, plan 160 et début de 161) émet un faible cliquetis vraisemblable, alors que dans la séquence de l’arrivée à Ibiza il ne produit aucun son. Il fallait distinguer pour notre étude le maletín ouvert et fermé dans la mesure où le garrot devenu visible ne sonne plus comme un « cluster » mais se décompose, pour filer la métaphore musicale, en un bruit arpégé, les deux pièces de l’instrument étant dissociées puis superposées (pl. 27-28). L’attention obsessive portée à la bande-son peut entraîner, nous l’avons dit d’entrée, des hallucinations, des mirages, en un mot des erreurs. C’est pourquoi nous avons toujours tenté de vérifier l’écoute de certains phénomène sonores. Il est une occurrence du maletín qui nous a semblé particulièrement significative parce que plus mystérieuse, proche d’un message subliminal. Au plan 119, José Luis, assis à l’arrière de la jeep, tient sur les genoux la fatale mallette. Dans le tintamarre des klaxons et des cris, distincte d’un ronronnement de moteur, une sourde vibration métallique parcourt l’arrière plan sonore, comme pour marquer l’éveil de la machine de mort, jusqu’alors en sommeil, ou devenue simple mot intégré au dialogue ou, comble de l’abstraction irréalisante, titre du livre de Corcuera.
On constatera que la bande-son plus que l’image de la mallette est expression de l’horreur qu’elle renferme. Outre sa fonction de leit-motiv, le maletín semble avoir été la cellule sonore, le diapason fédérateur d’une bonne part du bruitage du film. Le tableau fait apparaître, à des moments stratégiques, en particulier les attaques de séquence, une prédominance de sons ou de vibrations métalliques. Bruits mécaniques (moteurs, machinerie de bateaux, machine à écrire), métallisation de la voix humaine par des hauts-parleurs, parfois montrés en premier plan (pl. 90, 142). Les musiques, à l’exception du quatuor de la Cueva del Drach et de la voix de Agustin Gonzalez, ont une source sonore métallique
(tuyaux de l’orgue, cuivres et autres instruments à vent des fanfares ou ensembles de jazz). Lorsque la vie quotidienne de José Luis et Carmen semble gagnée par la normalité, il serait absurde de surinterpréter chaque occurrence métallique comme une vibration en phase avec le garrot. Néanmoins, la construction circulaire, symbolique du transfert de l’office d’Amadeo à José Luis, est bien confirmée par le rappel sonore dejà signalé, et subtilement préparé puis imposé au spectateur qui a été conditionné par cette polyphonie qui se vrille aux confins de la conscience.
Car El Verdugo est une fable qui transcende la saisie réaliste et anecdotique d’une chronique costumbrista. Pour qualifier le bruitage du maletín, Berlanga a trouvé les mots justes : « Es una sensación muy de tripa que ya nos relaciona con todo lo que tiene la película de siniestro, de visceral, ¿ no ? » Une analyse du montage et du mixage des premiers et derniers plans du film permettent de mesurer la portée de ces propos. Le film commence par un bol de soupe qui voisinera, quelques plans plus avant, avec la mallette de mort. Cette antithèse sera soulignée par un étrange « raccord » sonore. Le gardien repousse le bol dont le contenu a refroidi. Le récipient est bruité en premier plan sonore. A son frottement sur la table répond, dans le plan cut suivant, avec la même intensité, le raclement du cercueil du condamné[10]. Raccord éminement arbitraire, par conséquent métaphorique, où la compréhension passe par la sensation, où le corps est le premier médiateur dans la saisie de la signification. Tout repose sur la suggestion d’un froid soudain. La contiguïté de l’humble aliment, source de vie maintenant refroidie dans le bol, avec ce cadavre encore tiède, dans le cercueil des pauvres, provoque un rire dont le lamento du gitan confirmera, sur la fin de la séquence, l’essence tragique.
Cette métaphore de la matérielle contiguïté de la vie et de la mort sera filée dans la deuxième apparition du maletín. Amadeo déballe l’instrument de son gagne-pain sur la table où José Luis boit un café un peu amer. Mais c’est surtout au plan final 161 que toutes les ressouces du montage audio-visuel seront mises au service de la fable et de sa morale. On sait que la fugue est une forme complexe où s’entrecroisent plusieurs voix, plusieurs thèmes. Quand vient le moment de conclure, le musicien resserre tous les éléments qu’il a developpés dans une « strette ». Le plan 161 joue ce rôle et le maletín y manifeste sa nécessaire présence. Dans la polyphonie de caquètements de poulets encagés — autres condamnés à mort —, de bruits de moteurs ou de machinerie, le maletín est de nouveau au premier plan lorsque José Luis le laisse choir sur le plancher du ferry. L’instrument de mort se retrouve en contiguïté avec les aliments : biberon de l’enfant, sandwich dont l‘enveloppe de papier froissé est sonorisée de manière très soulignée. La métaphore, filée depuis le plan 20, trouve ici son aboutissement. C’est la raison pour laquelle nous n’avons jamais qualifié cet effet sonore de gag. On ne peut parler ici de « mickeymousing » dans la mesure où l’effet n’est pas ponctuel et burlesque puisqu’il ne « ponctue » pas systématiquement les apparitions du bagage et qu’il n’irréalise pas l’image qu’il accompagne. La mise en phase des vibrations métalliques tout au long du film et l’association entre le garrot et les aliments contribue à souligner la continuité et la « viscéralité » de cette perception qui déclenche le rire. Et si l’on veut bien se souvenir du sens de twist, c’est à dire torsion et non pas seulement contorsions d’une danse pour des miss et leurs sigisbées, on verra que la musique finale n’est pas un processus de fuite vers l’ailleurs mais un rappel humorisique de la technique d’exécution en même temps que l’image de l’avenir qui s’ouvre pour José Luis, le nouveau bourreau.
La bande-son ne peut prétendre signifier de manière autonome. En dépit de tout, son cheminement perceptible ou secret, ses entrées fracassantes ou ses resurgences plus insidieuses ont contribué à mettre en perspective les conventions de la comédie telles que les pratiquaient les metteurs en scène espagnols et italiens, y compris Berlanga dans ses premiers films. El Verdugo est une comédie qu’il serait absurde de vouloir transformer en réflexion bergmanienne sur les fins dernières. Mais dans le même temps il faut comprendre pourquoi ce film occupe toujours une place à part dans les recensions des oeuvres servant de référence pour définir ce genre cinématographique. Les personnages de José Luis, d’Amadeo et Carmen comptent parmi les plus approfondis du cinéma espagnol. Comme nous avions décidé de nous en tenir aux phénomènes sonores à l’exclusion de la parole, nous n’avons pu introduire dans la polyphonie du film les voix ,si profondément incarnées, viscérales elles aussi, de José Isbert et d’Emma Penela. Le timbre voilé ou rauque de ces deux personnages, ainsi que la voix plus claire du comédien qui double si parfaitement Nino Manfredi, ont contribué à rendre charnellement inoubliable la morale de la fable du bourreau, sa fille, son gendre et la mort. Charnellement. L’étude de la bande-son a ses limites et aussi ses avantages. La dictature de la rhétorique et de la linguistique peut s’y faire moins pesante. On constatera que nous avons évité autant que possible les emprunts habituels aux figures de rhétorique qui nous ont semblé inadaptées pour décrire la bande-son. Seul un ingénieur acousticien aurait pu nous proposer le métalangage convenable pour une analyse des signes sonores. Pour pallier l’absence de ce guide, nous avons décidé d’écouter le film plutôt que les rhéteurs. Berlanga nous a révélé la source d’où monte le sens qui transforme le bruitage du maletín en leit motiv et lui restitue sa qualité de bruit à part entière, loin des effets comiques, dans toute l’ambiguïté menaçante du compagnonnage entre la vie et la mort à la frontiére desquelles retentit son sinistre signal.
Sans idéalisation populiste, sans prêche ni grandiloquence métaphysique, El Verdugo est le rappel d’un constat : la liberté est un luxe inconnu de tous ceux qui, sans être des exclus ou des marginaux, voient s’enfuir les jours dans la bataille quotidienne de la survie. Ce que l’on nomme le hasard n’est pour eux que l’enchaînement mécanique des besoins les plus naturels et irrépressibles, parfois compliqués d’envies ou de désirs. Mais toute satisfaction se paie au prix fort. Dans leur fable, lestée d’une pesante réalité, plus viscérale que sociale, les auteurs de ce film n’ont prononcé envers leur personnage qu’un seul interdit : ils ne peuvent prétendre au tragique. Il leur reste le vaste territoire du dérisoire dans lequel nulle musique mélodramatique ne les survole, menaçante ou bienveillante. Ils ont pour tout compagnons de route les bruits de ce qu’il est convenu d’appeler la vie. La vibration du maletín court sous ce tintamarre. Parfois il émerge pour marquer les étapes d’un requiem des illusions, des bonheurs, des évasions, musique funèbre que les protagonistes n’entendent ou n’entendront même plus. Si le spectateur rit à ce film, c’est la peur au ventre. Qui oserait, alors avoir l’impudeur de se moquer du maladroit José Luis, de la superbe Carmen et du très normal Amadeo ? Qui peut s’exclure de la cohorte attendrissante et comique des survivants ?
Accepter de s’en tenir à l’écoute du son d’un film comporte trop de limites pour prétendre en tirer la morale. Un son n’a pas de sens, la sémiologie des phénomène sonores est en déroute ou s’est soumise à la récupératrice de la théorie de l’énonciation. Pourtant, dans ce film, où nous avons signalé quelques repères pour la construction de la fable, donc du comique et de sa portée éthique, le spectateur, sans le bruitage devenu bruit du maletín, n’irait pas chercher au plus profond de ses angoisses les racines de son rire. Gardons-nous d’oublier cette plongée organique pour ne pas répéter, sous d’autres formes mieux pensantes, les errements der la censure franquiste. On sait que les censeurs avaient éxigé la suppression de la sonorisation du maletín. Ce contexte politique et idéologique sera étudié par ailleurs et il est d’une importance capitale. Mais, pour qui s’aventure dans la chambre d’écho d’une oeuvre cinématographique, tout devient rencontre de l’informulé, dans un territoire immense, sans bornes, mouvant, fantastique, nocturne. Peut-être l’infilmable songe de la raison[11]. Comme on a pu le vérifier, l’exercice de la censure favorise l’émergence des fantasmes. Les censeurs étaient aussi des survivants comme les personnages du Verdugo. Aujourd’hui que le film retentit de nouveau de la terrible vibration du maletín, on ne peut leur reprocher que d’avoir choisi, dans leur désir d’exorcisme, la fuite répressive et non le rire libérateur. Leur censure dit assez qu’ils avaient compris le film. Ils n’ont pas eu le courage d’accepter de rire de la mort. Ce rire qui tire sa liberté de l’instinct de survie et contre lequel nul ordre, fût-il moral, ne peut ni ne pourra jamais rien.
[1] Luis García Berlanga, Le bourreau, découpage de E. Larraz et J.C Seguin, l’Avant-Scène, n°465, Oct. 1997.
[2] Pour la distinction entre musique d’écran et musique de fosse, cf. Michel Chion, le son au cinéma, Cahiers du cinéma, 1985, p. 149-177.
[3] Le clin d’oeil attendu par tout spectateur habitué des films de Berlanga a été ici intégré à l’univers musical. Le chanteur qui se gargarise dans la sacristie se prépare après l’art sacré du matin à exercer ses talents profanes le soir, lors de la Première d’une opérette viénnoise qui nous sera épargnée : Idilio Austro Hungaro . Les musiciens des années 60 connaissaient ausssi les nécessités du pluriempleo comme le confirme l’eclectisme des jazzmen des Pompes Funèbres.
[4] Michel Chion, Le son au cinéma, p. 161.
[5] Sydney Bechet a enregistré ce thème pour la première fois le 21 janvier 1952. Cf Christian Béthune, Sydney Bechet,ed. Vade Retro, p. 83-84.
[6] Organista. Te he dicho que hay que afinar el órgano. Ahora ya fallan dos notas en dos registros. Avant Scène, pl.69,p.63.
[7] Cf. J.L. Dutronc, « Les contes d’Hoffmann : une genèse laborieuse, une partition contestée », l’Avant-Scène Opéra, n° 25, pp.13-17.
[8] Cf pour le contexte de cette épisode, cf Jacques Terrassa, « Majorque dans le bourreau », l’Avant-Scène, n°465, p. 96-99.
[9] Dans le tableau nous avons distingué la prison 1 de la 2. Non seulement en raison d’un changement de décor, mais surtout, dans le cadre de notre présentation, de la différence de traitement sonore. La prison 1 est très brutalement sonorisée, avec des bruitages de serrures, clés et fermetures de porte en premier plan, alors que dans la prison 2 les grincements et fermetures/ouvertures l’explosion reverbérée d’une polyphonie de pas, de gémissements, de piétinements avant le claquement de porte final qui répond en écho à celui de la prison 1 (pl. 22).
[10]On retrouve cet effet de percussion métallique dans la rythmique de la guitare du générique. Rappelons que le film est une coprodution hispano-italienne. Asins Arbó a écrit cette musique introductive comme un clin d’oeil en hommage à Nino Rota, le compositeur des films de Fellini.
[11] Pour un début d’analyse du apport entre le son et l’infilmable, cf Michel Chion, « Trois sons »,Vertigo, n° 3 ,p.57-58.