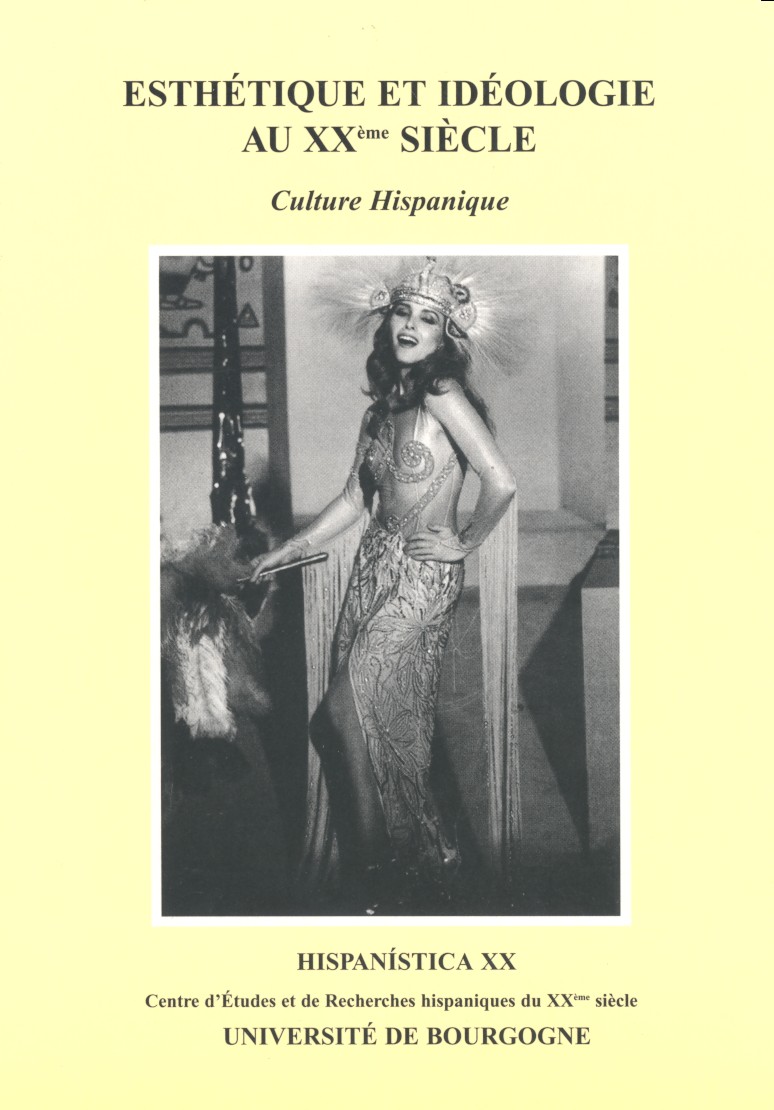Prix : 18 euros + frais postaux
n°20
Sommaire :
Yolanda MILLÁN : Estética e ideología en el cine musical de la democracia : reflexiones sobre La corte de Faraón (1985) de J.L. García Sánchez
Antonio DOMÍNGUEZ LEIVA : La fea burguesía (1971-1980), de Miguel Espinosa como deconstrucción ideológica del tardofranquismo
Magali DUMOUSSEAU-LESQUER : Punk, glam, pop, pegamoïdad et autres modernos … L’esthétique vestimentaire de la movida madrilène ou lorsque le no future se transforme en sólo se vive una vez
Eva NAVARRO : Anarquía y terrorismo estético en la obra de José Ángel Mañas : la Literatura Punk
María SILVESTRE-GUIN : Histoire d’une rupture : Autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún
Estefanía SALDÍAS LARRAMENDI : Los Abanicos del Caudillo o el franquismo más allá de su muerte
Didier CORDEROT : Adoctrinar deleitando, el ejemplo de la revista “Pelayos”
Arantxa FUENTES : Le dialogue entre esthétique et idéologie : vers une poétique d’Antonio Machado
Ma Francisca VILCHES DE FRUTOS : Compromiso y vanguardia en La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca
Emmanuel LE VAGUERESSE : Esthétique et idéologie dans El Jarama (1955) de Rafael Sánchez Ferlosio : quelques réflexions sur un roman critique sans en avoir l’air
Nicolas BONNET : Ortega et l’insoutenable légèreté de l’art
Carole DOMINGUES : Art et politique : le noucentisme catalan et la réponse galicienne de l’atlantisme
Dorita NOUHAUD : El canto de la kora
Marie-Madeleine GLADIEU : Les débuts du roman policier péruvien : un nouveau regard porté sur la société
Guy THIEBAUT : Histoire (mexicaine) et farce théâtrale : le cas de El atentado de Jorge Ibargüengoitia
Emmanuel LARRAZ : L’esthétique néoréaliste dans le cinéma espagnol des années soixante : Los farsantes (1963) de Mario Camus
Lire un article
L’esthétique néoréaliste dans le cinéma espagnol des années soixante : Los farsantes (1963) de Mario Camus
Emmanuel LARRAZ
Université de Bourgogne
La réalité d’une société profondément meurtrie qui n’avait pu être montrée à l’écran dans l’Espagne de l’immédiat après-guerre, a commencé à faire son apparition dans les années cinquante, alors que la censure se relâchait quelque peu. Des cinéastes tels que Juan Antonio Bardem (1922), Luis García Berlanga (1921) et Fernando Fernán Gómez (1921), influencés par la découverte des films néoréalistes italiens, aspiraient alors à prendre la relève des réalisateurs qui, comme José Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil ou Juan de Orduña, s’étaient mis au service de la dictature.
Leur exemple va être suivi dans les années soixante par une nouvelle génération de cinéastes nés dans les années trente : Jaime Camino (1936), Mario Camus (1935), Basilio Martín Patino (1936), Carlos Saura (1932), Manuel Summers (1935)… que l’on a regroupés parfois sous l’étiquette du Nouveau Cinéma Espagnol.
Pour son premier long métrage, Los farsantes (1963), Mario Camus s’est résolument inscrit dans l’esthétique du néoréalisme, poussé par le désir de témoigner, de montrer pour la dénoncer, dans les limites autorisées par la censure, une réalité sociale consternante. Se penchant sur la vie des acteurs de théâtre déjà évoquée par Juan Antonio Bardem, également dans son premier long métrage, Cómicos (1954), il a voulu offrir un témoignage sur la dureté de cette profession et sur la cruauté de la société espagnole de l’époque à l’égard des comédiens les plus pauvres qui étaient considérés comme de véritables parias.
Le spectacle de la misère
Comparée à la vie déjà difficile des comédiens qu’avait montrée Juan Antonio Bardem, dix ans auparavant, dans Cómicos, hommage à la profession de ses parents, Rafael Bardem et Matilde Muñoz Sampedro, l’existence des acteurs ambulants que met en scène Mario Camus, apparaît comme un véritable cauchemar. Il ne s’agit plus ici des inconvénients des tournées harassantes en province, dans des théâtres plus ou moins décrépits, mais de compatir aux souffrances de pauvres hères qui courent tous les jours après le gîte et le couvert.
Dès le début, le scénario écrit en collaboration par le réalisateur et Daniel Sueiro donne la tonalité de ce premier long métrage de Mario Camus consacré aux comédiens les plus misérables :
Los cómicos de la legua. Las aventuras y aún más las desventuras de los componentes de la Compañía llamada Teatro de don Pancho por el nombre de su empresario y director.
En una derrengada camioneta van arrastrando su triste miseria, de pueblo en pueblo, de villorio en villorio, huyendo aquí de los acreedores que los persiguen, escapando allá de la burla cruel y despiadada de los lugareños. Incapaces de luchar, derrotados y fatalistas, su pobre humanidad vive aferrada a los más elementales instintos de conservación[1].
Mario Camus s’est éloigné de l’orthodoxie du mouvement néoréaliste en travaillant avec de vrais acteurs et non avec des interprètes non professionnels comme l’avait fait par exemple Vittorio de Sica dans Le voleur de bicyclettes (1948) ou dans Umberto D (1952). S’agissant d’un film à petit budget, les acteurs avec lesquels il avait dû tourner n’étaient pas de grandes vedettes. C’était le cas, par exemple de Víctor Valverde dans le rôle de Lucio, le plus jeune comédien de la troupe et de Fernando León qui interprétait le personnage de Rogelio, un ex-légionnaire qui va finir par partir avec la recette. La seule vedette était en fait Margarita Lozano, dans le rôle de Tina, l’actrice principale de la petite troupe théâtrale, en butte non seulement à la misère quotidienne comme ses compagnons d’infortune, mais aussi au mépris profond des hommes qui, à cette époque, n’établissaient pas toujours une distinction très claire entre une comédienne et une prostituée. Lors de l’unique vrai repas de tout le film, qui est celui que Rogelio et Tina prennent chez un vieux camarade de l’armée que l’ex-volontaire de la División Azul a rencontré par hasard dans un village, Tina éprouve le besoin de préciser que cette mauvaise réputation des actrices n’est pas toujours justifiée : « Las mujeres de teatro tenemos mala fama. En esto suelen pagar justos por pecadores ».
Rappelons que Margarita Lozano qui avait une solide formation théâtrale jouissait alors d’une certaine célébrité grâce au rôle de Ramona, la servante, qu’elle venait d’interpréter dans Viridiana (1961) de Luis Buñuel. Le personnage de Tina qu’elle jouait avec un extraordinaire mélange de vulgarité et de dignité était défini dans le scénario comme une femme mûre, encore belle, qui conservait une certaine prestance mais qui laissait voir les premiers symptômes de la « décadence imminente ». Pour le cinéma espagnol de l’époque, un détail consigné dans le scénario suffisait à lui donner une connotation défavorable : elle fumait.
Signalons également l’interprétation de Luis Ciges, d’une grande sobriété, dans le rôle de Justo, le dernier des membres de la petite troupe théâtrale qui n’avait droit qu’à de petits bouts de rôle et devait s’occuper en priorité de l’intendance. Après des études à l’Ecole de Cinéma de Madrid et le tournage de quelques courts métrages, Luis Ciges n’avait joué que de petits rôles jusqu’à ce que Luis García Berlanga le découvre dans Plácido (1961).
Selon les principes du mouvement néoréaliste qui convenaient par ailleurs parfaitement à un producteur aussi pingre que l’était Ignacio Farrés Iquino, la majorité des séquences ont été tournées en décors naturels, soit dans la rue et dans de vraies maisons, soit dans la plaine désolée de Castille. Un carton indique d’ailleurs, au début du film, que toute l’équipe remercie les maires des villes de Valladolid, de Sepúlveda et de Pedraza « pour les facilités accordées lors du tournage ».
La tonalité réaliste du film est également renforcée par l’inclusion, alors que l’on appoche du dénouement, de brèves scènes documentaires montrant, en forte plongée, des moments de la procession de la Semaine Sainte de Valladolid que les comédiens sont censés regarder depuis le balcon de la maison de passe où ils ont trouvé refuge.
Auparavant l’errance de la misérable troupe les avait conduits dans des villages délabrés, frappés par l’exode rural, et où ils avaient eu bien du mal à rassembler un nombre suffisant de spectateurs qui puissent leur assurer une recette leur permettant de payer le gîte et le couvert. Le scénario évoquait ainsi leur douloureux périple sur les routes défoncées de Castille :
En esto ya se sabe : hoy hay y mañana no hay. Van de un lado a otro echando mano de lo que pueden y poniendo la cara que mandan. De aquí para allá con los zapatos rotos y el hambre amaestrada en los insensibles, soñolientos, silencios agitados sobre la caja de una vieja camioneta.
Ces vagabonds sont par ailleurs mal vus des autorités des villages où ils débarquent. Il arrive que le curé, par exemple, éprouve le besoin de vérifier la décence du spectacle qu’ils proposent aux paysans, en demandant au préalable une copie de la pièce qui va être jouée. Il s’agit bien évidemment du reflet de la réalité puisque, dans l’Espagne des années soixante, l’Eglise s’était arrogé le droit de contrôler et de censurer tous les spectacles au nom de la défense des bonnes mœurs qu’elle prétendait garantir. La réalité évoquée par Mario Camus est bien plus noire que celle qu’avait montrée Juan Antonio Bardem dans Cómicos. Si ce dernier dénonçait la précarité des conditions de vie des acteurs et notamment lorsqu’ils devaient partir pour d’interminables tournées en province, les comédiens que montre Mario Camus se retrouvent au plus bas de l’échelle dans la profession, et se contentent d’essayer de survivre au jour le jour. La tonalité sombre du film est donnée dès la première séquence qui est une séquence macabre où l’on découvre cette troupe de dix comédiens (trois femmes et sept hommes) en train de veiller, dans le théâtre vide d’une petite ville, l’un des leurs qui vient de passer de vie à trépas. Endettés, car ils ont dû interrompre les représentations pendant quelques jours à cause de la maladie de leur compagnon, ils doivent s’enfuir comme des voleurs pour éviter que les autorités ne confisquent leur unique bien, les costumes miteux et les maigres décors qui leur permettent d’exercer de façon quasi héroïque leur métier. Voyant qu’ils sont insolvables, la propriétaire de la modeste pension de famille où ils avaient trouvé à s’héberger, n’hésite pas à les mettre à la porte sans ménagements en jetant leurs pauvres bagages par la fenêtre.
Transis de froid, obligés, lorsqu’ils n’ont pu jouer, de dormir à la belle étoile, ils ne sont jamais assurés de pouvoir manger. La menace obsédante de la faim montre de façon saisissante que dans l’Espagne du début des années soixante, plus de vingt ans après la fin de la guerre civile, la misère était une réalité quotidienne pour ceux qui se trouvaient tout au bas de l’échelle sociale. Le directeur et imprésario de la troupe, don Pancho, exhibe quant à lui un embonpoint qui proclame qu’il a réussi à échapper aux pénuries et son optimisme à toute épreuve le pousse à toujours aller de l’avant. C’est ainsi qu’il propose, sans succès, il faut le reconnaître, de jouer le soir même où ils viennent d’enterrer leur compagnon. Dans le village suivant où la recette a été fort maigre, il doit prendre une décision véritablement cornélienne puisqu’il lui faut choisir entre le gîte et le couvert. La sagesse lui fait privilégier la nourriture et les quelques piécettes qu’ils viennent de récolter sont consacrées à un frugal repas plutôt qu’à la location de chambres pour tous : « Cojan las mujeres un cuarto y nosotros aquí o en la camioneta ».
Dans la présentation de l’errance de ces baladins la tension dramatique naît du fait qu’ils ont conscience que leur situation qui est déjà critique va s’aggraver encore avec l’arrivée de la Semaine Sainte pendant laquelle tous les spectacles profanes étaient interdits. Ils vont donc se retrouver sans travail et sans ressources et c’est la raison pour laquelle don Pancho qui a le devoir d’assurer l’existence de la troupe, s’efforce de mettre quelque argent de côté. Dans l’exemplaire du scénario conservé à la Bibliothèque Nationale à Madrid, il est clairement indiqué que cette semaine sans ressources est très éprouvante pour les comédiens :
La farsa y la fiesta se detienen todos los años en la Semana Santa. Baja el telón el lunes y no vuelve a levantarse hasta el domingo. En Semana Santa no se trabaja y esos días dramáticos, nebulosos, agónicos, para nadie lo son tanto como para la gente de la farsa.
Le chômage était, de toutes façons, la hantise de tous les acteurs, même de ceux qui jouaient dans les grands théâtres de Madrid et de Barcelone, car aucune indemnisation n’était prévue dans ce cas, et ils devaient alors, pour subsister, vendre ou gager les quelques objets précieux qu’ils possédaient. Fernando Fernán Gómez a raconté dans ses mémoires que c’était précisément par peur que sa mère l’actrice Carola Fernán Gómez ne connût le chômage, que sa grand-mère, qui pourtant l’adorait, écartait l’idée qu’il puisse faire des études :
Mi abuela opinaba que mi madre no ganaba dinero suficiente para darme una carrera, sobre todo por la frecuencia de las paradas en las que había que empeñar los mantones de Manila y las escasas y modestas joyas, y que yo debía elegir un oficio limpio : cajista de imprenta, ebanista[2] …
C’est l’espoir de gagner une coquette somme juste avant que ne commence la Semaine Sainte qui fait que don Sancho accepte une représentation privée chez des bourgeois qui avaient assisté par désœuvrement à l’un des spectacles de la troupe dans un village. L’on découvre bien vite que ces nantis qui croient que l’argent leur donne tous les droits n’ont invité les comédiens que pour se divertir à leurs dépens. On les voit donc se comporter avec une rare grossièreté en ne respectant pas le travail de leurs invités. C’est ainsi qu’ils se mettent à applaudir avec force et avant qu’il n’ait fini de déclamer l’un des morceaux de bravoure du répertoire espagnol, le monologue de Sigismond dans La vie est un songe de Calderón de la Barca, la prestation de don Pancho qui comprend ainsi qu’il doit se retirer. L’humiliation est poussée à son comble avec le numéro pathétique du strip-tease de la malheureuse Tina. Cette séquence qui aurait pu être piquante dans une Espagne où la nudité considérée comme peccamineuse était pourchassée par les censeurs devient poignante du fait que l’actrice a su rendre le malaise que ressentait son personnage, en acceptant, pour de l’argent, de se prêter à ce spectacle dégradant. Cette séquence poignante est l’un des grands moments du film et l’on y trouve sans nul doute l’un des plus grands numéros d’acteur du cinéma espagnol de l’époque. Margarita Lozano qui avait alors trente-deux ans était au sommet de son art et elle a su exprimer le trouble et la souffrance du personnage de Tina, déchirée entre l’humiliation de devoir se déshabiller sans grâce sur un air à la mode et l’espoir de gagner un peu d’argent. Elle parvient à être tout à la fois émouvante, ridicule et tragique, dans le numéro pitoyable qu’elle offre en pâture à des spectateurs totalement insensibles.
L’hommage du cinéaste aux comédiens
Montrer l’extrême misère des comédiens ambulants mais aussi leur acharnement à exercer une profession décriée par les autorités et les petits bourgeois qui ne pouvaient comprendre sa noblesse était une façon pour Daniel Sueiro et Mario Camus, co-auteurs du scénario de Los farsantes, de leur rendre hommage. Daniel Sueiro avait déjà travaillé avec Mario Camus et notamment en 1959, lorsqu’ils avaient participé à l’écriture du scénario de Los golfos, le premier long métrage de Carlos Saura, leur ami commun.
Romancier et journaliste, Daniel Sueiro était un écrivain engagé, mû par le désir de témoigner de l’existence de la misère, de l’injustice et de la violence dans une Espagne que la propagande du régime tendait à idéaliser et à présenter comme pacifiée et forte. N’oublions pas que c’est juste un an après le tournage de Los farsantes, que le régime franquiste va lancer une spectaculaire campagne pour persuader les Espagnols de la légitimité du coup d’Etat de 1936 et des bienfaits de la politique du Caudillo qui, après la guerre civile présentée comme nécessaire pour remettre de l’ordre, venait de leur offrir « vingt-cinq années de paix ». Daniel Sueiro, Mario Camus, Carlos Saura et bien d’autres intellectuels et artistes avaient, quant à eux, l’ambition de dénoncer cette vaste manipulation de l’opinion publique en mettant en lumière les zones d’ombre que les thuriféraires du dictateur s’efforçaient au contraire d’occulter. C’est exactement en 1964, vingt-cinq ans après la fin de la guerre, que Carlos Saura tourne son troisième long métrage, La caza, qui est aussi son premier chef-d’œuvre. Il y montre l’échec profond de ceux qui tenaient alors le haut du pavé, de ceux qui apparaissaient comme les vainqueurs de la guerre, et il suggérait que la paix, tellement encensée par le régime, n’était que la paix des cimetières.
Le grand livre de Daniel Sueiro reste un livre documentaire d’une érudition impressionnante sur un sujet qui était d’une brûlante actualité dans l’Espagne de Franco : El arte de matar (L’art de tuer). Il s’agissait d’une enquête très fouillée sur la peine de mort à travers le monde qui ne manquait pas de faire la part belle à la spécificité espagnole : l’usage, pour l’exécution de la peine capitale, du célèbre garrot. Daniel Sueiro connaissait très bien la réalité de la société espagnole et lors de sa première collaboration avec Mario Camus pour l’écriture du scénario de Los golfos, c’est le cinéaste qui avait signalé à Carlos Saura l’intérêt d’une série de reportages sur la délinquance des jeunes madrilènes :
Creo que fue Mario quien sugirió la idea de leer unos reportajes que había hecho Daniel Sueiro en una revista sobre el mercado de Legazpi. Entonces localizamos a Sueiro, hablamos con él y surgió la idea de Los golfos. … Nos basamos muchísimo en los reportajes de Sueiro, en cosas reales que él había visto o había vivido allí; y para escribir el guión muchas veces fuimos a los escenarios descritos por Sueiro. Hicimos realmente una indagación en el mercado de Legazpi, hablamos con gente, observamos y creo que en cierta forma la película respondió a eso, a una cierta realidad[3].
L’on retrouve cette même volonté de montrer la vie réelle et incroyablement dure des comédiens ambulants dans Los farsantes. Il est remarquable que dans la fiction même du film, les bourgeois qui les ont découverts lors d’une représentation dans un village et qui les ont invités pour se distraire, expriment l’étonnement qui a été le leur en voyant des gens vivre de façon si précaire : «No sé cómo pueden vivir… Son como Marcianos, seres de otro planeta».
Le film montre par ailleurs que la société espagnole se trouve alors à un tournant de son évolution vers plus de modernité qui coexiste avec des formes archaïques de subsistance. Alors que les mésaventures des comédiens de don Pancho rappellent, par certains aspects, les aventures picaresques des troupes ambulantes qu’évoquait déjà au XVIIème siècle Agustín de Rojas dans Le plaisant voyage (El viaje entretenido), la radio que l’on laisse entendre à plusieurs reprises sur la bande son, évoque le projet d’une communauté européenne à laquelle l’Espagne pourrait bientôt adhérer…
Il faut toujours tenir compte de l’existence de la censure qui limitait la portée du message qu’aurait pu délivrer Mario Camus qui par ailleurs était débutant dans la carrière et devait également se plier aux exigences du producteur Ignacio Farrés Iquino qui recherchait en priorité la rentabilité.
Il y a un aspect de la vie des comédiens, la liberté de leurs mœurs, qui était abondamment développé dans le scénario de Los farsantes, mais qui a été sensiblement réduit lors de la mise en scène. Fernando Fernán Gómez, déjà cité, qui vient d’une famille d’acteurs et dont le témoignage est toujours précieux, a raconté dans ses mémoires que les comédiens qui souffraient profondément de l’ostracisme de la société espagnole à leur égard, éprouvaient par contre une certaine fierté et même un léger sentiment de supériorité à l’égard des autres catégories sociales où les relations entre hommes et femmes étaient moins spontanées :
Existía una profesión en la que el número de hombres que trabajaban era igual al de mujeres. Ensayaban los unos con las otras las escenas de amor… Y cuando salían a trabajar por las provincias vivían en las mismas pensiones, en los mismos hoteles. Y muchas veces el actor y la actriz que figuraban en la cabecera del cartel no eran matrimonio: estaban liados y eso a nadie le parecía mal, o si les parecía mal hacían la vista gorda… ¿Sentíamos los cómicos orgullo de aquella situación? Es posible. No tener que disimular que entre nosotros había adúlteros, bígamos, estupradores, abortistas, jugadores profesionales, maricas, chulos y que nos sentábamos todos a la misma mesa y trabajábamos en el mismo taller nos hacía creernos un poco superiores a los que se veían obligados a ser hipócritas aun en contra de sus buenas tendencias. Era lo único en que podíamos sentirnos superiores, era nuestra pequeña compensación[4].
Dans Los farsantes, la situation matérielle des pauvres acteurs est tellement précaire qu’il était difficile de donner une image aimable de leurs relations amoureuses. Tina, l’actrice principale, est la maîtresse de Rogelio, l’ex-volontaire de la División Azul sur le front russe, qui la traite durement et elle est désirée par un autre acteur, Avilés, qui n’est pas non plus un modèle de délicatesse. Le jeune premier, Lucio (Víctor Valverde) et Milagros qui joue les rôles de servante ressentent une grande attirance physique l’un pour l’autre, mais ils ont bien du mal à se retrouver seuls et à préserver une certaine intimité à cause des difficultés constantes de la troupe pour se loger.
Le scénario évoque également de façon tout à fait explicite une relation homosexuelle entre Curro, le jeune danseur de flamenco et Vicente, un acteur plus âgé. Tous deux sont unis, indique le scénario, par « une amitié malsaine ». La censure de l’époque, sous la coupe de l’Eglise catholique qui défendait l’ordre moral, se méfiait de la représentation de toute relation amoureuse trop explicite ou en dehors de la stricte orthodoxie des liens du mariage. Si elle tolérait l’évocation de conduites « déviantes », de l’adultère ou « d’amitiés particulières », ce n’était que dans la mesure où la morale canonique finissait par s’imposer alors que les pécheurs étaient dûment condamnés. C’est ainsi que les auteurs du scénario avaient bien pris la précaution de condamner l’amitié entre Curro et Vicente, présentée comme une aberration dont ils se sentaient eux-mêmes honteux. Par exemple, l’apparition d’un prêtre dans la rue, alors qu’ils se rendent au théâtre, fait immédiatement réagir Vicente : «quita la mano con la que rodeaba el hombro de Curro».
L’on avait trouvé auparavant l’évocation d’une scène beaucoup plus manifeste dans une pension de famille où la troupe avait été hébergée. Le scénario précisait que Vicente s’était arrangé pour se retrouver seul avec son ami dans une chambre, après avoir fait sortir le jeune premier, Lucio. Il peut alors s’approcher de Curro et commencer à le caresser :
Le pasa la mano por la cabeza, acariciándole el pelo largamente. Curro se deja hacer. Vicente está dulzón y empalagoso:
Vicente: Ya verás como ahora se cuida mucho de molestarnos.
La mano de Vicente se ha bajado por la espalda y ha cogido por los hombros a su amigo estrechándole contra sí. Forman un cuadro al lado de la ventana con sus forzadas posturas y sus caras apenas visibles a contraluz.
Après le travail d’expurgation des censeurs l’on ne retrouve plus, dans le film, que quelques indices fugaces de cette relation homosexuelle qui peut passer totalement inaperçue pour un spectateur moyennement attentif. Cependant, vers la fin du film, alors que le jeune Curro, tenaillé par la faim, délire et se met à danser le flamenco en solitaire, dans une sorte de transe, jusqu’à s’écrouler sur le sol de la chambre de la maison de passe de Valladolid, en nage et le regard halluciné, l’on voit Vicente s’approcher de lui et lui caresser tendrement les cheveux. La caméra se détourne pudiquement, à cet instant, en un lent panoramique qui laisse voir les corps allongés et exsangues des autres comédiens.
Dans leur souci de montrer la réalité de la vie de ces derniers comédiens ambulants, Mario Camus et Daniel Sueiro s’étaient également interessés à leur répertoire, et l’on découvre dans le film qu’il était extrêmement réduit car leurs moyens étaient limités et composé pour l’essentiel de mélodrames. Les titres qu’annoncent les affiches sont éloquents : Compañía Francisco Moreno en su gira por España. Repertorio : Genoveva de Brabante, La Huérfana de Ginebra. Vanidad y Pobreza. Con variedades y rifas. Por los mejores intérpretes.
Don Pancho, acteur et imprésario, est bien évidemment capable de réciter des tirades d’autres pièces et notamment, comme on l’a vu, le célèbre monologue de Sigismond de La vie est un songe. Il peut également mettre très rapidement sur pied une saynète religieuse que la troupe joue, avec l’accord du curé de la paroisse, sur le parvis de l’église, afin de préparer les fidèles à la célébration de la Semaine Sainte, mais il est clair que la troupe obtient ses plus grands succès avec la représentation de l’inusable légende de Geneviève de Brabant, déjà racontée au XIIIème siècle par Jacques de Voragine.
Rappelons que la pauvre Geneviève, fille du duc de Brabant, avait été confiée par son époux Siegfried, palatin de Trêves, au félon Golo, son intendant. Celui-ci chercha vainement à la séduire et il finit, pour se venger, par l’accuser d’adultère. Il la fit condamner à mort par Siegfried et chargea des sicaires d’exécuter la sentence. Ceux-ci eurent pitié de Geneviève et l’abandonnèrent avec son enfant dans une forêt où elle vécut plusieurs années de fruits et de racines. Son enfant fut nourri du lait d’une biche qu’elle avait apprivoisée.
Le film consacre plusieurs séquences à la représentation de Genoveva de Brabante, et il montre notamment l’un des moments les plus émouvants de cette sombre histoire : l’heureux dénouement où triomphe la sincérité de la malheureuse duchesse. L’on voit comment Siegfried qui avait suivi la biche à la chasse, retrouve son épouse qui lui prouve son innocence et lui présente son fils, de sept ans déjà, qu’elle a élevé à force de sacrifices. Le scénario indiquait précisément la façon dont les acteurs devaient interpréter cette scène en disant les vers d’une façon grandiloquente, selon la tradition, comme il convenait, pensaient les comédiens ambulants, de faire parler des personnages si importants :
En el aire los versos de Genoveva de Brabante, dichos con toda su entonación, a la antigua, creando el aire de drama en cada estrofa, poniendo cara de buenos o de villanos, haciendo amplios y soberbios ademanes como ellos creen que haría un rey, un noble o una princesa. Las ropas les desfiguran levemente. Los mantos y las caras empolvadas dificultan el inmediato reconocimiento de los que están actuando. Las voces suenan, ahuecadas, potentes, llenando el ámbito cercano.
Le plus extraordinaire est que la magie du théâtre agit malgré toutes les imperfections de la mise en scène et l’inconfort de la salle de classe qui sert de salle de spectacle pour les habitants du village. Et lorsque Siegfried, enfin convaincu de l’innocence de l’héroïque et pure Geneviève, ouvre ses bras pour accueillir sa fidèle épouse et le tendre enfant qu’elle avait élevé seule, avec le plus grand dévouement, les applaudissements se font entendre et beaucoup, jeunes ou vieux, ne peuvent s’empêcher d’essuyer une larme :
Sigfrido: Te creo desdichada Genoveva,
Ven a mis brazos y deja
Que ellos sean un trono para tu honor,
Y un gran consuelo a mis penas.
Ven aquí, hijo mío, corre, vuela.
Genoveva: ¡Tu hijo! Cuando te fuiste, quedé encinta,
Y hoy, mi amado Sigfrido,
Tu retrato fiel contempla.
Ce sont finalement ces trop rares moments qui peuvent panser les blessures d’amour propre des pauvres baladins et leur faire oublier toutes leurs mésaventures en leur redonnant une certaine dignité. L’on voit là que même les plus humbles des comédiens participent à la grandeur du théâtre, à la magie de ce spectacle capable d’arracher, ne serait-ce que quelques instants, les spectateurs les plus frustes au prosaïsme de leur vie quotidienne. Et c’est probablement la conscience plus ou moins confuse qu’ils ont de cette dignité qui leur donne la force d’aller de l’avant, même si, comme le dit amèrement Justo (Luis Ciges), celui qui occupe le poste le plus modeste au sein de la troupe, il y a peu de chances pour que leur condition s’améliore alors que commence, avec la fête de Pâques, la nouvelle saison théâtrale : «No ha cambiado nada. Todo sigue igual. por lo menos no vamos a engañarnos».
La fin du film reste donc ouverte à l’espoir de connaître encore quelques uns de ces trop rares moments de bonheur en présence d’un public ému par les fictions qu’ils ont incarnées devant lui.
Le jeune Mario Camus qui essayait en 1963 d’entrer dans la carrière cinématographique dont l’accès était semé d’obstacles savait que la dignité des plus humbles des comédiens qu’il avait montrée à l’écran n’était pas totalement étrangère à celle qu’il essayait lui-même de conquérir dans une société qui tendait à étouffer l’expression artistique. S’inscrire dans le courant néoréaliste pour son premier long métrage, témoigner avec les modestes moyens d’un film à petit budget, impliquait une prise de position éthique et c’était pour le cinéaste manifester également son désir de trouver lui aussi son public :
Mis personajes eran un poco como mi propia vida, no tenían la comprensión del público ni de los dueños de los locales, era la misma frustración que sentíamos todos[5].
Fiche technique
Los farsantes (1963)
Production : I.FI. España.
Scénario : Mario Camus et Daniel Sueiro, à partir du texte Fin de fiesta de Daniel Sueiro.
Opérateur : Salvador Torre Garriga.
Musique : Enrique Escobar.
Costumes : Llorens.
Montage : Ramón Quadreny.
Prise de son : Miguel Sitges.
Maquillage : Práxedes Martínez.
Producteur en Chef : Antonio Liza.
Assistant Réalisateur : José Corbalán.
Second Opérateur : Juan Gelpi.
Script : Francisco Siurana.
Studios : I.F.I
Sonorisation : Parlo Films, S.A.
Laboratoires : Cineatiraje, S.A.
Interprètes : Víctor Valverde (Lucio), Margarita Lozano (Tina), José María Ovides (don Pancho), José Montez (Curro), Angel Lombarte (Avilés), Fernando León (Rogelio), Luis Tornes (Vicente), Luis Ciges (Justo), Consuelo de Nieva, Amapola García, Mario de Bustos, José Rivelles, Florencio Calpe, María Clevilla, Camino Delgado, Irene D’Astra, Leonor Tomás, Paloma Iriarte.
Durée : 90 minutes
Tournage : du 19 mai au 20 juin 1963.
[1] Los farsantes, guión, Madrid : Biblioteca Nacional, sign : T/ 39459.
[2] Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo. Memorias. 1921-1943, Madrid : Edit. Debate, vol. 1, 1990, p. 165.
[3] Enrique Brasó, Carlos Saura, Madrid : Taller de Ediciones J.B., 1974, pp. 61-62.
[4] Fernando Fernán Gómez, Desde la última fila (cien años de cine), Madrid : Espasa Calpe, 1995, p. 72.
[5] Juan Carlos Frugone, Oficio de gente humilde … Mario Camus, Valladolid : Ed. Semana de Cine de Valladolid, 1984, p. 56.