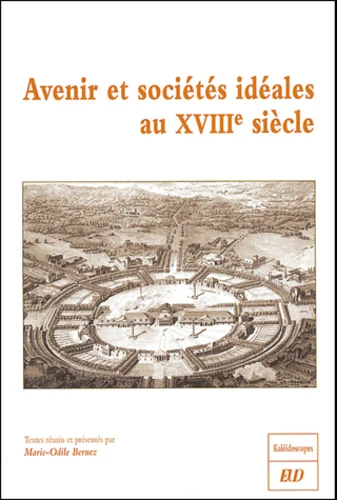La société idéale n’est plus seulement, pour les hommes du dix-huitième siècle, un âge d’or perdu, mais un avenir à construire. En valorisant les idées de progrès et de changements, penseurs, philosophes et écrivains envisagent le présent non plus par rapport au passé, mais par rapport à un avenir idéal. Ils s’efforcent également de le faire advenir, par le biais de l’architecture notamment. Au-delà des grands penseurs de la perfectibilité humaine, comme Condorcet ou Godwin, ce recueil étudie ainsi les applications parfois difficiles d’idéaux utopiques, dans les réformes agraires ou l’urbanisme, qui montrent la difficile prise en compte de l’avenir dans la gestion du présent.
Préface :
Au tout début de la dixième époque de l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Condorcet pose la question : « Si l’homme peut prédire, avec une assurance presque entière, les phénomènes dont il connaît les lois ; si lors même qu’elles lui sont inconnues, il peut, d’après l’expérience du passé, prévoir avec une grande probabilité les événements de l’avenir, pourquoi regarderait-il comme une entreprise chimérique celle de tracer avec quelque vraisemblance le tableau des destinées futures de l’espèce humaine, d’après les résultats de son histoire ? » Cette question rhétorique est immédiatement suivie du développement à grands traits des progrès futurs de l’humanité, selon trois axes : « la destruction de l’inégalité entre les nations ; les progrès de l’égalité dans un même peuple ; enfin le perfectionnement réel de l’homme » l’optimisme du XVIIIe siècle est ici résumé, dans ces termes d’égalité et de perfectionnement, dans cette utilisation de mots tels que loi et expérience. Ici semble s’affirmer le triomphe des Lumières sur l’obscurantisme, sur les théories chimériques : la raison, par le biais de l’expérience, doit nous permettre de trouver les lois du développement historique et moral, qui amènera les hommes vers l’égalité et le perfectionnement, et donc, on n’en peut guère douter à l’orée de cette époque de bouleversements révolutionnaires, à plus de bonheur. On n’a que trop insisté sur l’ironie qui consista pour Condorcet à écrire ces lignes alors qu’il finissait ses jours traqué par la police de ses anciens amis politiques.
Mais plus qu’un paradoxe, ou une ironie, c’est bien là la consécration de tous les efforts des philosophes et des penseurs des Lumières. Le mouvement est parti, comme souvent, des développements scientifiques, et en ce sens l’interrogation de Condorcet est révélatrice. En assurant sur des bases semble-t-il inébranlables les fondements des sciences physiques et chimiques, les scientifiques, qui sont souvent aussi des philosophes (on pense à Priestley bien sûr, chimiste, religieux et réformateur) ont ouvert la voie à l’optimisme en matière également de société et d’histoire. S’il y a des lois de la nature, l’homme faisant partie de cette nature est lui aussi soumis à ces lois. Une fois qu’il les connaît, il lui suffit de déduire à partir d’elles les grands événements historiques et le tour est joué. L’avenir de l’humanité est aussi mathématiquement prévisible que la chute des corps. Mais heureusement, cet avenir n’est pas voué à la chute, mais bien au contraire au progrès.
En effet, au-delà du caractère scientifique de la déduction de l’avenir à partir de principes déterminés, le passé doit guider les prédictions. Et ce passé, n’a-t-il pas révélé des progrès étonnants, dans les moeurs et dans les mentalités ? Il y a, pourrait-on dire, une excuse à croire à un avenir radieux, quand les philosophes font le compte des progrès accumulés dans les siècles passés. C’est justement d’ailleurs le but de Condorcet dans les neuf premiers tableaux de son Esquisse : les progrès sont tangibles, réels. Rien là-dedans d’inventé, de rêvé, de chimérique. Si les hommes du xvIIIe siècle croient en un avenir meilleur, c’est qu’ils regardent rétrospectivement le chemin parcouru, et se félicitent déjà des progrès accomplis. C’est que l’ignorance est en passe d’être vaincue, grâce à l’invention de l’imprimerie, c’est qu’on a mis un terme à la barbarie du servage, ce qui laisse espérer la fin de l’esclavage, c’est que les châtiments cruels d’antan commencent à se démoder, et qu’il est même possible d’envisager l’abolition de la peine de mort. Les progrès techniques sont indéniables, et s’accompagnent forcément de progrès moraux, selon la plupart des auteurs du dix-huitième siècle.
Bien sûr, la crainte, voire la tentation de la décadence, existe, et le succès d’un ouvrage comme celui de Gibbon, Le Déclin et la chute de l’Empire Romain, est là pour confirmer que l’homme doit rester sur ses gardes. Mais en vérité, il n’y a guère de raison que les progrès ne se poursuivent pas, et les lois de la nature font qu’en s’accumulant, ces progrès s’accélèrent et que le retour en arrière n’est plus possible. Mary Wollstonecraft, à la même époque que Condorcet, écrit que rien ne pourra remettre en question les progrès accomplis par l’invention de l’imprimerie, et que, l’égalité et la liberté allant de pair avec l’extension du savoir, elles sont destinées à toujours s’accroître, même si parfois elles rencontrent des obstacles. « La cruauté des Romains à demi-civilisés, combinée à leurs vices contre nature, même à une période où la littérature et les arts étaient florissants, prouvent que la compassion est fille de la réflexion, et que seuls les progrès des arts et des sciences peuvent rendre les hommes plus sages et plus heureux.’ » Les tyrans n’osent plus montrer leurs vices en plein jour, comme au temps des Romains, et peu à peu les tortures, autrefois sanctionnées par les lois, sont abolies. Ainsi, l’évolution des mentalités dans le siècle même où ils vivent conduisent les penseurs et théoriciens à espérer, voire à prédire, toujours plus de progrès.
L’étude faite sur le mot « avenir » dans l’Encyclopédie démontre d’ailleurs de façon brillante que c’est même justement en ce qui concerne les croyances superstitieuses à propos de la possibilité de prédire le futur que les Lumières ont été le témoin des progrès réalisés par les mentalités. Croire que l’on peut deviner le futur, qu’il est inscrit et ne demande qu’à se dérouler, que les dieux l’ont déjà déterminé et que certains, par le biais de pratiques magiques, peuvent y avoir accès, c’est de la superstition dont les Encyclopédistes se gaussent. Par contre, déduire l’avenir des lois de la raison, et vouloir influer sur cet avenir en modifiant l’environnement des hommes, c’est tout autre chose, c’est le signe que l’histoire n’est plus répétitive, circulaire ou prédéterminée, mais qu’elle se déroule sur la flèche d’un temps orienté, que l’homme peut infléchir grâce à ses efforts. Car il ne s’agit pas seulement de pouvoir contempler un avenir radieux, une société idéale, en un mot une utopie où l’homme trouvera, ou retrouvera, le bonheur. L’avenir n’est plus entre les mains des dieux, mais entre celles de l’homme, qui a désormais les capacités d’une part de le découvrir de manière scientifique, mais également de le forger à l’image de ses désirs.
Dans ce sens, Condorcet trace une ligne de démarcation entre le simple futur et le véritable avenir, qui doit, d’ailleurs, pour mériter ce nom, s’enraciner dans le passé, ce que prouve la démarche logique de l’Esquisse. Bien sûr, on aurait beau jeu de nos jours d’accuser ces optimistes de confondre progrès techniques et progrès moraux, qui sont sans doute bien distincts. Il serait facile de réfuter toute idée de progrès moral, à l’aube du XXIe siècle, alors que force est de constater que les espoirs des Lumières ne se sont pas réalisés. Lier les progrès techniques au bonheur et à la moralité semble une idée aujourd’hui dépassée. Mais les penseurs du XVIIIC siècle n’avaient pas encore eu le loisir de contempler les siècles suivants…
Certains auteurs d’ailleurs se détachaient déjà de l’optimisme ambiant. Marivaux en ce sens est un bon contre-exemple. Chez lui, les sociétés idéales ne sont là que pour nous amener à réfléchir sur l’ici et maintenant, et à accepter avec plus d’allégresse un fardeau dont on ne peut se débarrasser. L’avenir, l’utopie, pour Marivaux, c’est un prétexte pour regarder en face le présent, car les hommes, et les femmes, fondamentalement, ne changeront pas. Ce n’est pas une voix discordante dans un concert d’optimisme béat, plutôt, la musique inimitable de Marivaux, préoccupé du concret plus que de l’abstrait, des anecdotes plutôt que des grandes idées, du cours de la vie, plutôt que des gigantesques bouleversements. D’autres auteurs se serviront de l’avenir pour dénoncer le présent : on pense en particulier à Louis Sébastien Mercier, dont L’an 2440 n’est pas une vision futuriste, mais une critique du Paris de son temps. D’ailleurs, cet avenir où on brûle les livres est bien noir par rapport aux projections des philosophes.
On ne peut détacher la croyance en un avenir meilleur de l’idée que l’homme peut se forger son propre destin, qui est un signe de la sécularisation et de l’individualisme croissants de la société des Lumières dans son ensemble. En effet, si les philosophes croient que les moeurs peuvent s’améliorer, c’est qu’ils ont foi dans l’influence de l’éducation et de l’environnement sur l’enfant et l’adulte. Changeons le milieu où vivent et évoluent les hommes, nous changerons les hommes, semble être leur slogan. Appliquons ces règles scientifiques qui nous ont permis de percer les secrets du comportement de la matière, et nous pourrons à notre gré régler le comportement des hommes. Ainsi, les schémas utopiques voient-ils dans le milieu le cadre indispensable d’une régénération de l’homme. C’est ainsi que William Godwin, en plaçant l’homme dans de petites communautés rurales, espère lui éviter les vices traditionnellement associés à la ville. De la même façon, tous les grands réformateurs des moeurs à cette époque insisteront sur l’éducation, car si l’individu a des aptitudes particulières — comme semble à l’époque le prouver Lavater — son milieu doit lui permettre de les épanouir au mieux. Le lien entre avenir et éducation est donc indissoluble.
Pourtant, on ne peut s’empêcher de penser que l’avenir proposé est souvent à la fois utopique et passéiste. Ainsi, Godwin, en voulant lutter contre les excès de l’urbanisme et du luxe, a des relents nostalgiques, même s’il prend soin d’assurer, lui aussi, que grâce à l’imprimerie, à l’extension des connaissances, on ne pourra retomber dans l’état de barbarie. Dans les efforts de colonisation de la Sierra Morena, on voit également s’introduire la même erreur : les individus à l’origine du projet ont semble-t-il eu en tête un archétype humain, auquel ils font correspondre une ferme modèle, et ils ne se soucient pas du caractère unique des hommes qui se trouvent lancés dans l’aventure, avec leurs désirs, leurs exigences religieuses ou irrationnelles, voire simplement leurs besoins immédiats. Quand on essaie de mettre en oeuvre l’utopie, on se heurte inévitablement au réel, avec ses particularismes, comme le montre ce projet presque avorté, mais typique des Lumières.
Les architectes et premiers urbanistes voient aussi sur la scène des villes se mêler l’utopie et le réel. Il leur faut prendre en compte les besoins des hommes, mais également leur donner un cadre de vie qui fera d’eux des hommes meilleurs, et plus heureux peut—être. Mais la vision architecturale peut être également singulièrement tournée vers le passé, peut—être même doit—elle se tourner vers le passé, et le signe le plus évident de la modernité, c’est au tournant du XVIIIe siècle, chez les pensionnaires de l’Académie de France à Rome, le retour à l’antique, première vague de la lame de fond néo—classique qui va balayer la France jusqu’à l’Empire.
C’est que l’on ne construit pas l’avenir et ses sociétés idéales uniquement en se fondant sur des mirages, des utopies, produits d’un nulle part séparé de l’histoire. Même les missionnaires qui s’enfoncent dans les coins les plus reculés de l’Afrique voient dans le continent noir une possibilité de régénération, mais fondée sur une évangélisation antérieure. Quant aux femmes écrivains, elles essaient de s’accommoder du présent en traçant un chemin pour les générations futures. Leur combat est une leçon pour les générations futures, et nous ramène bien sûr à la place centrale de Condorcet dans la question de l’avenir, puisqu’il fut un des seuls à y discerner l’égalité des sexes, à y donner une place aux femmes.
C’est qu’en fin de compte, l’avenir se construit au présent, et que les visions d’avenir qu’ont eues les générations précédentes les ont conduites sur la voie des développements actuels. En somme, en s’efforçant de se rapprocher de leurs visions idéales, elles ont contribué à forger notre présent, bien différent sans doute de ce qu’elles imaginaient quand il n’était encore qu’un avenir lointain.
Table des matières :
Introduction (pp. 9-13)
Jean-Paul Schneider : Le Mot “avenir” dans l’Encyclopédie (pp. 15-29)
Charles Coutel : Condorcet et la question de l’avenir (pp. 31-36)
Marie-Odile Bernez : L’Avenir selon William Godwin (pp. 37-43)
Lucette Desvignes : Marivaux et les sociétés idéales (pp. 45-53)
Laurent Giraud : L’Afrique, avenir de la religion chértienne dans L’Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes d’Afrique (1776) de l’abbé Proyart (pp. 55-63)
Sylvie Lamy-Marchenoir : L’Avenir des femmes vu par les publicistes et les romancières allemandes à la fin du XVIIIème siècle (pp. 65- 80)
Pierre Grisard : La “Colonisation” de la Sierra Morena : vers une société rurale idéale (pp. 81-90)
Dominique Lanni : Le Génie couronné : le retour à l’antique comme vision d’avenir chez les pensionnaires de l’académie de France à Rome à la fin du XVIIIème siècle (pp. 91-98)
Martine Jacques : De l’Utopie au futur : émergence du réel dans le rêve urbanistique (pp. 99-110)