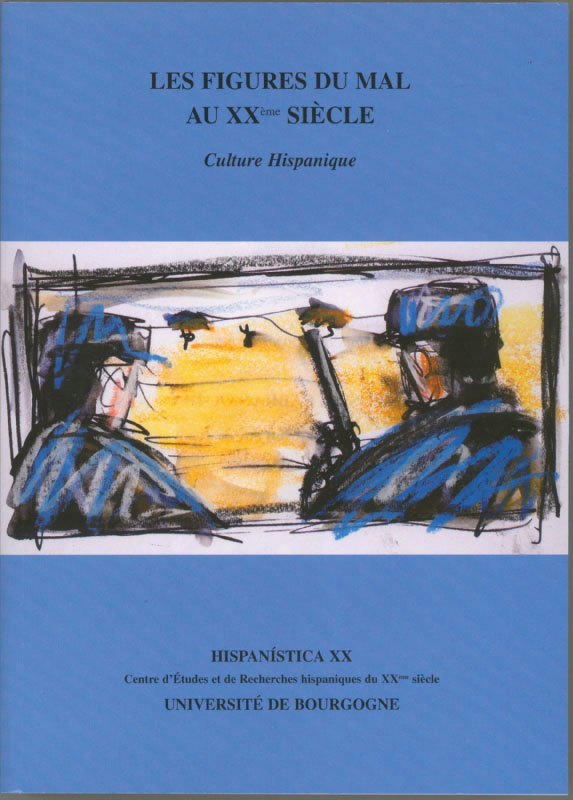Prix : 21 euros + frais postaux
n°22
Sommaire :
Marie-Madeleine GLADIEU : Les Andes et le Mal de José María Arguedas à Mario Vargas Llosa
Aline JANQUART-THIBAULT : Un Mal, des mots : Asturias, Arguedas et le paradis perdu
Mónica ZAPATA : El pulular de los monstruos: de Silvina Ocampo a César Aira
Silvia LARRAÑAGA : Paradoja del Mal, discurso subversivo y apología de la muerte en El desbarrancadero de Fernando Vallejo
Stéphanie URDICIAN : Les incarnations dramatiques du Mal dans le premier théâtre de Griselda Gambaro (1965-1972)
Nicolas BONNET : La place du mal dans la pensée d’Ortega y Gasset
Hélène FRETEL : La représentation du “ mal ” et du “ bien ” dans les langues espagnole et française
Christian BOIX : Le bon, le mal et le truand dans Lo real, de Belén Gopegui
Gilles DEL VECCHIO : El club Dumas de A. Pérez-Reverte : le repaire du diable
Anne CHARLON : Carmen Laforet et les démons
Jean TENA : La inversión de un símbolo: las palomas maléficas de Javier Tomeo (La ciudad de las palomas, 1989)
Cécile VILVANDRE : Sufrimiento y horrores cotidianos en Amado monstruo de Javier Tomeo
Cécile BERTIN-ELISABETH : Des formes du Mal et de leur exacerbation dans le Lazarillo de Tormes et Nuevas andanzas del Lazarillo de Tormes de C. J. Cela
Cécile IGLESIAS : Destin poétique de quelques figures malfaisantes du folklore enfantin hispanique
Claudie TERRASSON : La poésie de Luis Antonio de Villena : alchimie du mal
Álvaro MONTOYA RODRÍGUEZ : Don Juan : mito e inversión. Tratamiento de lo trascendente en la versión de Torrente Ballester
Lydie ROYER : L’énigme du Mal dans No acosen al asesino
Isabelle STEFFEN-PRAT : Un triptyque du mal : Plenilunio, Sefarad et Ventanas de Manhattan d’Antonio Muñoz Molina
Anne PAOLI : La buena letra, de Rafael Chirbes : une représentation kaléidoscopique du mal
Catherine ORSINI-SAILLET : Les métamorphoses du mal dans Cielos de barro de Dulce Chacón
Evelyne RICCI : Le vertige de la décadence : Antonio de Hoyos y Vinent face au mal
Antonio DOMINGUEZ-LEIVA : Etología del mal y autobiogafía delirante: La vida secreta de Salvador Dalí
Jocelyne AUBÉ-BOURLIGUEUX : De l’éclosion d’une “ marguerite ” à l’incarnation de “ Marguerite ” dans “ Sangre de los campos ” (1918) : vers la première tentation de l’écriture du pacte satanique chez Federico García Lorca
Florence BELMONTE : L’humour pour conjurer le mal : Forges et le franquisme
Emmanuel LE VAGUERESSE : La figure du mal dans L’horrible docteur Orlof (1961) de Jesús Franco : un hommage singulier du cinéma de (sous-) genre à l’histoire mondiale du cinéma d’horreur
Emmanuel LARRAZ: L’esprit de la ruche de Víctor Erice et l’énigme du mal
Lire un article
Carmen Laforet et les démons
Anne Charlon
Université de Bourgogne
Los demonios están en todas partes del mundo. Se meten en el corazón de todos los hombres[2].
Ces phrases extraites, pour les deux premières du célèbre sermon que la tante Angustias inflige à Andrea, la protagoniste-narratrice de Nada, le lendemain même de son arrivée à Barcelone, et, pour les deux suivantes, de La isla y los demonios, résument les différentes figures du mal construites par Carmen Laforet dans ses cinq romans. Le discours moralisateur d’Angustias situe le mal dans sa dimension sociale et religieuse : le mal c’est ce que la morale catholique (et plus précisément « nationale catholique ») et la société (concrètement la société espagnole du premier franquisme) réprouvent. Pour Marta, la jeune héroïne de La isla y los demonios, le mal ce sont les démons intérieurs que chaque être humain porte en lui. Et c’est précisément autour de ces trois axes (social, religieux et psychique) que Carmen Laforet poursuit, de roman en roman, une réflexion sur le mal qui peut sembler obsessionnelle. En effet, l’exploration des différentes formes que peut prendre le mal dans l’âme et dans les conduites humaines, l’analyse de ses causes profondes constituent certainement un fil conducteur essentiel dans une carrière littéraire caractérisée par la discontinuité. A l’immense succès qu’obtient la très jeune romancière -elle a alors vingt-trois ans- avec Nada, suivent huit années de silence –La Isla y los demonios paraît en 1952- ; la romancière semble alors reprendre une production plus suivie avec la publication d’un recueil de nouvelles, La llamada, en 1954 et d’un troisième roman, La mujer nueva, en 1955 ; or c’est un nouveau silence de huit ans qui précède la publication de La insolación, en 1963 ; le roman constitue, selon les dires de Laforet[3], le premier tome d’une trilogie déjà achevée, pourtant, les deux volumes suivants ne paraissent pas ; comme le précise Agustín Cerezales[4], en 1973 la romancière corrige les épreuves du second volume, elle ne les renverra jamais à son éditeur, et c’est seulement en 2004 que Destino publie Al volver la esquina, sur l’initiative des enfants de la romancière.
Si la présence obsédante du mal dans les fictions de Laforet constitue un axe fédérateur, les approches qui en sont faites dans les différents romans participent de la discontinuité, et contribuent, peut-être, à l’expliquer. Un événement dans la vie de Carmen Laforet, événement très visible et très lisible dans sa production romanesque, bouleverse la perception et la diction du mal. Il s’agit de la révélation brutale de Dieu, et de la conversion au catholicisme, dont rend compte le troisième roman, La mujer nueva. Laforet, tout en utilisant fréquemment les mots « diable » ou « démon », avait envisagé jusqu’alors le problème du mal avec le regard d’une agnostique ou de quelqu’un que la pratique religieuse intéresse peu (les « prêchi-prêcha » d’Angustias ou de certains personnages de Laisla y los Demonios étant plus grotesques que convaincants) ; elle intègre, avec La mujer nueva, l’analyse du mal dans une vision empreinte de sentiment religieux, mais il serait inexact de dire « intègre dorénavant » car les deux tomes de la trilogie inachevée, s’ils prennent plus en compte que les deux premiers romans la dimension de la foi face au problème du mal, ne semblent cependant pas y avoir trouvé une réponse totalement satisfaisante.
C’est donc sous les signes opposés de la permanence et de l’évolution que vont être analysés les trois aspects les plus caractéristiques de l’écriture du mal dans les fictions de Carmen Laforet : la relation entre morale sociale et mal, les démons intérieurs et les possibles barrières contre le mal.
La première déclinaison du mal dans les romans de Laforet est à situer dans le binôme très classique Mal versus Bien et très exactement dans le cadre des règles morales établies. Or, ce qui frappe dans Nada et La Isla y los demonios c’est la distance critique vis-à-vis de ces règles qu’exprime la construction des personnages et du récit. Les héroïnes des deux premiers romans sont deux adolescentes idéalistes qui ont soif de liberté et aiment le vagabondage. Andrea et Marta ne cherchent pas les aventures sentimentales ou sexuelles, elles cherchent à comprendre le monde qui les entoure, sont mues par la curiosité, le désir de voir, de sentir ou d’apprendre ; dans les deux cas le récit met en évidence leur pureté. Or les adultes (oncles, tantes, demi-frère etc.) qui constituent leur famille (l’une et l’autre sont orphelines) voient le mal partout -en particulier là où il n’est pas- et attachent plus d’importance aux apparences qu’à la réalité. L’itinéraire d’Andrea apporte un démenti formel à tout ce que prédisait Angustias au moment de son départ : « Ya sé que hasta ahora no has hecho nada malo. Pero lo harás en cuanto me vaya…¡Lo harás! ¡Lo harás! Tú no dominarás tu cuerpo y tu alma[5]. » Andrea est reçue à ses examens, ses promenades dans Barcelone, ses rencontres avec des jeunes gens sont à mille lieues de la débauche ; au contraire, au contact des autres, la jeune fille a appris à se défendre et à défendre ses valeurs, elle a acquis de la maturité. Le cas de Marta, dans La isla y los demonios est peut-être encore plus clair ; elle éprouve un amour platonique pour Pablo, un peintre, et aime se promener et discuter avec lui, ce qui, bien sûr, fait jaser : « No sabía que a aquellas horas había gente que hablaba de sus paseos con el pintor como algo pecaminoso y sin precedentes en una criatura de su educación[6]. » Face à ces commérages, Pablo finit par lui dire qu’il ne veut plus la voir et, par dépit, la jeune fille entame un flirt sans conséquences avec Sixto, ce qui provoque un nouveau mélodrame, scandalise la « bonne société » canarienne et suscite la fureur du demi-frère de Marta qui, en réalité, redoute surtout une aventure sérieuse et une demande en mariage qui l’obligerait à lui restituer les biens qu’elle a hérités. La isla y los demonios oppose deux personnages féminins, Marta, qui a une quinzaine d’années et Honesta, la mal nommée, une femme d’âge mûr. Si Marta n’est pas, contrairement à ce que prétend la rumeur publique, une jeune fille légère, elle est d’une grande imprudence ; sa tante Honesta, au contraire, cumule les aventures en conservant les apparences. Et c’est ce modèle que tout le monde souhaite imposer à Marta, même si, dans le roman, seul, Daniel, son oncle, prend la responsabilité de le dire clairement :
-Hay que andar con precauciones… […] Todo se puede hacer si se guarda el decoro, nenita. Pero el decoro, ¿eh…? ¿No te gusta que te dé un pellizquito…? Tu pobre tío Daniel es un viejo ya. Sí, sí, hay que guardar el decoro… Te advierto que aquí están un poco enfadadas tus tías. Matilde es algo puritana… Y Hones nunca rompió las formas… Las formas son algo importante, nenita; éste es el consejo de un viejo tío tuyo… Dame la manita…[7]
On remarquera au passage à quel point le texte fait de Daniel le prototype même du viejo verde ! A la fin du roman, ce sont les adultes, et en particulier le peintre Pablo, qui détruisent les illusions et l’innocence de Marta, qui a, en effet, surpris les ébats de Pablo et Hones :
Lo que ellos hacían le hizo perder de un golpe todas sus ideas sobre el pudor y la decencia. […] Más tarde empezó a sufrir… no de celos, ni de envidia, porque su cuerpo era demasiado joven y su amor por Pablo demasiado espiritual, demasiado lleno de idealismo para eso. Empezó a sufrir de asco[8].
Et, quelques temps plus tard, l’instance narrative note que Marta : « Nunca volvería a ser la criatura ciega y feliz de antes[9]. »
Les deux premiers romans de Laforet mettent ainsi en évidence l’opposition entre le Bien et le Mal comme valeurs absolues et le bien et le mal tels qu’ils sont reformulés par la morale en vigueur dans la société, et l’on peut affirmer qu’ils soulignent le divorce entre la Morale -apanage de la jeunesse encore pure parce que non contaminée par le monde- et la Société.
Carmen Laforet a huit ans de plus lorsqu’elle écrit La isla y los demonios et le récit manifeste déjà quelques différences avec Nada, puisqu’il montre une certaine inconscience de la part de Marta, en particulier lorsqu’elle va seule rejoindre Pablo et doit passer la nuit dans un hameau isolé. Cet aspect apparaît plus clairement dans La mujer nueva ; peut-être parce qu’elle est, elle-même, plus loin de l’adolescence, peut-être parce que sa récente conversion au catholicisme a profondément changé sa conception de la morale, Carmen Laforet abandonne l’apologie d’une éducation libre sans toutefois renoncer à la critique de certaines façons de vivre la foi. Ce qui oblige surtout le lecteur à émettre un jugement plus circonspect sur l’inopérance de la morale traditionnelle, c’est la durée que recouvre le récit. Dans le présent du récit l’héroïne, Paulina, a entre trente et quarante ans ; à travers l’évocation de la protagoniste adolescente, le texte crée un personnage très proche d’Andrea et Marta, d’idéaliste qui s’est construit une morale personnelle très exigeante, comme le prouve le discours que Paulina tient à son premier fiancé :
-No se trata de ‘atraparte legalmente’, como una señorita de provincias ansiosa de marido… No se trata de esto. Pero tengo que ser consecuente conmigo misma, Víctor. Odio la hipocresía. La he respirado demasiado en el aire de mi casa. Odio la suciedad en las acciones. Si quieres que me vaya contigo, mañana mismo me voy contigo a tu casa. Pero así, a la luz del día, con mi atadillo de ropa debajo del brazo… No te rías, no; te aseguro que es cierto. Nada de trampas legales, ni un papel firmado… Pero tampoco tapujos. Nada de engañar a mi abuela y recibir la pensión de mi padre como si tal cosa… No seré tu amante hasta que tú no te decidas a cargar con la responsabilidad de ello[10].
Cependant, l’instance narrative remarque, avec une certaine ironie : « Este lenguaje estaba de moda[11]» ; l’épisode se situe, en effet durant les années trente. A cette époque, Paulina a rejeté le catholicisme à cause de ses propres parents :
-Mi padre es de esos señores muy amigos de los curas, muy metido en la iglesia, que organiza procesiones y que luego tiene…amigas […]
Se callaba. Le daba vergüenza decirle a Víctor que su padre blasfemaba como un carretero, que tenía un genio del demonio, que, a pesar de su carrera y presumir de señor, era grosero con su madre, a la que había llegado a golpear cuando le hacía reproches por celos[12].
[…] La madre de Paulina era un mujer flaca, tosedora, con el genio avinagrado, los ojos enfermos de llorar y unos celos perpetuos consumiéndola. Se consolaba en la iglesia. Allí pasaba las tardes y parte de las mañanas. Paulina estaba harta de escuchar que a su madre los sacerdotes le aconsejaban resignación, resignación… Podía dar gracias a Dios de tener un marido creyente, que había hecho los nueve primeros viernes y no moriría en pecado porque Dios es misericordioso, sobre todo si ella tenía resignación[13].
Dans cet extrait c’est la morale catholique elle-même qui semble caractérisée par l’hypocrisie, mais l’itinéraire sentimental de la jeune femme qui, durant l’été 36, tombe amoureuse d’Eulogio, part avec lui et l’épouse ensuite civilement en zone républicaine, n’est pas présenté, dans le récit, comme exemplaire même si Paulina déclare, des années plus tard : « Aquello era algo limpio y joven[14]… »
Le roman s’interroge alors, implicitement, sur les dangers d’une éducation permissive ou simplement aveugle et suggère que même si certaines personnalités peuvent, malgré tout, se construire et se forger une morale, il arrivera toujours un moment où l’absence de normes posera problème. Ce qui, dans Nada et La isla y los demonios n’était que pureté, soif d’idéal pour les jeunes protagonistes, devient pour la femme adulte inadaptation, incapacité à vivre ; ce que les premiers récits donnaient comme qualité humaine indiscutable est revisité par un regard nettement plus critique. La technique du récit, dont le présent coïncide avec le désir exprimé par Paulina de rompre une relation adultère et qui est construit sur de nombreuses analepses, conduit le lecteur à établir des liens de cause à effet entre les années de formation et le manque de repères ayant amené la jeune femme à commettre tant d’erreurs.
Avec le roman suivant, La insolación, Laforet revient aux personnages d’adolescents mais le récit maintient une certaine ambiguïté quant à la morale qui le sous-tend. On retrouve une critique acerbe de l’hypocrisie avec certains personnages, comme Adela, la belle-mère du jeune héros, Martín, qui va à la messe tous les dimanches mais semble ignorer la charité et le respect d’autrui, puisqu’elle passe son temps à reprocher au jeune garçon ce qu’il mange et ce qu’il coûte, ou tel le médecin du village, un homme marié et « respectable » qui essaie de séduire la jeune Anita Corsi. Mais le récit empêche toute adhésion du lecteur aux personnages d’Anita et Carlos Corsi, des jeunes gens élevés hors de toute contrainte morale qui font surtout preuve de beaucoup d’égoïsme et d’inconscience. La insolación montre surtout le décalage entre la morale régnant en Espagne au début des années 1940 (le roman se déroule pendant les étés 1940, 41 et 42) et dans d’autres pays d’Europe : tel qu’il est construit, le roman ne donne pas raison à Anita Corsi qui agit avec une grande imprudence, en acceptant des rendez-vous avec des jeunes gens, mais encore moins aux habitants du village, comme le médecin et son fils qui proclament de grands principes sans les suivre. Quelques lignes expriment ce même décalage vu par Martín :
Por una parte, Anita y Carlos le producían una impresión de pureza y de inocencia que no había sentido jamás Martín delante de nadie. A principio de verano, para asombrarles, Martín les había contado algunos chistes de doble intención grosera y sexual que Martín conocía por sus amigos del instituto. Y Carlos y Anita casi no entendieron los chistes. Martín tuvo que explicárselos y a ellos no les hicieron gracia. Casi ni sonrieron. Y sin embargo en otras cosas, como en esta de la desnudez, a los dos les gustaba atormentar a Martín. Sobre todo a Anita le gustaba avergonzarle y reírse de él[15].
Les plaisanteries salaces apparaissent clairement comme partie intégrante de la répression sexuelle de l’époque, mais le désir de « tourmenter Martín » par la nudité prouve qu’Anita et Carlos ne la perçoivent pas totalement comme naturelle et innocente. Martín ne partage pas l’opinion des gens du village qui qualifient, entre autres termes aimables, Anita de « zorra »[16], il reste cependant perplexe et trouve parfois que la jeune fille a « la sonrisa mala »[17]. S’il y a distance ironique et critique vis à vis de la morale franquiste, il n’y a pas, dans La insolación, défense inconditionnelle d’une morale plus libre.
Certaines scènes du dernier roman, Al volver la esquina, évoquent avec ironie l’hypocrisie qui préside aux conduites sociales, ainsi celle des retrouvailles d’Anita et Martín, en 1950 ; les deux jeunes gens s’embrassent tendrement dans l’hopital où a été transporté le père d’Anita :
Una monja alta de cara severa y una enfermera de la que sólo recuerdo las gafas, han entrado en la habitación. Están mirándonos a dos pasos de nosotros. […] La monja está como clavada en el suelo y no contesta a la pregunta que le hace Anita de si desea algo. Vuelve la cara con desprecio y sigue adelante, hacia la habitación ya preparada para el enfermo. Allí la oímos andar durante medio minuto con pasos fuertes. Vuelve a pasar delante de nosotros lanzándonos una última mirada fulminadora[18].
Martín qui, contrairement à Anita, est né, a été élevé et vit en Espagne, essaie de calmer la jeune femme et de justifier les réactions de la religieuse et de l’infirmière ; mais son discours est chargé d’ironie pour les usages espagnols : « Digo que un beso, como sabe Anita, es algo totalmente prohibido en nuestra moral social. Hasta en las películas se censuran los besos. En los parques públicos los guardas acechan más a los novios que a los posibles ladrones[19]. » On retrouve ainsi, le ton de Nada et, plus encore, de La isla y los demonios mais le dénouement est beaucoup plus ambigu, comme si la romancière ne savait plus trop où se situent le bien et le mal envisagés dans leur dimension sociale.
Ce n’est toutefois pas cet aspect du bien et du mal qui occupe la place la plus importante dans les fictions de Carmen Laforet. Le mal qui obsède la romancière depuis Nada jusqu’à Al volver la esquina c’est le mal absolu, auquel aucun bien ne peut être opposé ; c’est ce qui se cache dans les profondeurs de la psyché, la part d’ombre de chaque individu, un mal qui ne se voit pas, qui donc, le plus souvent, échappe au jugement de la société.
Le début de Nada peut donner au lecteur l’impression d’une division assez simpliste et artificielle entre deux mondes opposés, symbolisés par deux espaces et deux couleurs : d’une part, le monde noir de la rue Aribau où réside Andrea et où cohabitent dans le drame sa grand-mère, ses oncles et tantes, bruns de peau, aux cheveux et aux yeux noirs, de l’autre, le monde clair et lumineux de la famille de son amie Ena. Tout est noir, rue Aribau, les murs, les vêtements :
Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de desesperanza[20].
Al levantar los ojos vi que habían aparecido varias mujeres fantasmales. Casi sentí mi piel al vislumbrar a una de ellas, vestida con un traje negro que tenía trazas de camisón de dormir. Todo en aquella mujer parecía horrible y destrozado, hasta la verdosa dentadura que me sonreía[21].
[Román] Tenía brillantes los ojos negros. La piel de su cara era morena y dura […] En el brillante y rizoso pelo negro[22]…
Le seul personnage, à part l’oncle Juan, dont les cheveux ne sont ni noirs, ni poivre et sel, est le membre extérieur de la famille, Gloria, la femme de Juan, mais ses cheveux sont qualifiés de « rojizos »[23] par la narratrice, on quitte donc le noir, pour le rouge, couleur diabolique s’il en est. Par contre, dans la famille d’Ena, tout le monde est blond : « Los padres de Ena y sus cinco hermanos eran rubios »[24], comme Ena[25] ; et toute la famille vit harmonieusement dans un appartement lumineux (« Me detuve en medio de la Vía Layetana y miré hacia el alto edificio en cuyo último piso vivía mi amiga. No se traslucía la luz detrás de las persianas cerradas, aunque aún quedaban, cuando yo salí, algunas personas reunidas, y, dentro, las confortables habitaciones iluminadas[26]. »)
Le lecteur est donc conduit à associer, d’autant plus spontanément que cette symbolique n’a rien d’original, la couleur noire aux sombres pulsions, à l’enfer, et la clarté morale à la lumière et à la blondeur ; ceci, en particulier, avec le personnage de Román l’ange noir, l’incarnation du mal :
-Mira, quería hablar contigo, pero es imposible. Tú eres una criatura… ‘lo bueno’, ‘ lo malo’, ‘lo que me gusta’, ‘lo que me da la gana de hacer’… todo eso es lo que tú tienes metido en tu cabeza con una claridad de niño. […] ¿Tú no te has dado cuenta de que yo los manejo a todos, de que dispongo de sus nervios, de sus pensamientos…? ¡Si yo te pudiera explicar que a veces estoy a punto de volver loco a Juan!…Pero, ¿tú misma lo has visto? […] ¡Si tú sintieras esta emoción tan espesa, tan extraña, secándote la lengua, me entenderías! […] Tú sabes muy bien hasta qué punto Juan me pertenece, hasta qué punto se arrastra tras de mí, hasta qué punto le maltrato. No me digas que no te has dado cuenta… Y no quiero hacerle feliz. Y le dejo así, que se hunda solo… Y los demás…[27]
Curieusement, tout au long de son œuvre, Laforet donnera à ses lecteurs des détails concernant la couleur des cheveux, des yeux et de la peau de ses personnages : Marta et son frère José ont les cheveux et la peau clairs : « Era [José] más rubio y más blanco que su hermana ; su piel parecía la de un nórdico porque no se tostaba[28]». Pino, la femme de José, « era una mujer bien plantada, joven, morena, de caderas amplias y cintura breve[29] ». Paulina, l’héroïne de La mujer nueva « era una mujer esbelta, con el cabello y los ojos intensamente negros[30] » ; son mari, Eulogio « era rubio, con ojos azules[31] ». Ces détails nous sont fournis dès les premières pages du roman, et la couleur de la peau et des cheveux sera précisée pour presque tous les personnages. On sait également que Martín (La insolación et Al volver la esquina) est très brun, que Anita Corsi était « una chica morena y feúcha, […] en contraste con aquel muchacho [son frère] que parecía un dios nórdico o poco menos[32] », tandis que l’étrange docteur Tarro, dans le second roman de la trilogie : « es rubio, lleva muy corto el rizado cabello[33]. »
En fait, dès Nada l’analyse du mal n’a rien de manichéen car Laforet s’emploie à brouiller la division noir/blond-clair qu’elle semblait suggérer et à montrer que le mal n’est pas l’apanage de la couleur noire. Si le noir est bien l’exacte expression de la couleur de l’âme de Román, celui-ci n’a pas l’exclusivité du mal, de ces pulsions destructrices ou autodestructrices qui torturent les personnages et les conduisent bien souvent à torturer leur entourage. Ces pulsions sont les démons auxquels Marta fait référence dans La isla y los demonios bien plus que ceux des légendes locales. Dans les deux premiers romans de Carmen Laforet, l’héroïne adolescente vit parmi des adultes au bord de la folie, dans un univers secoué de hurlements, de crises et de violence :
En seguida me di cuenta de que era Gloria la que gritaba y de que Juan le debería estar pegando una paliza bárbara. […] Pero los gritos continuaban, seguidos de las maldiciones y blasfemias más atroces de nuestro rico vocabulario español[34].
Enloquecida, Pino cogió el jarrón con las flores, como para lanzarlo a la cabeza de la niña. José, entonces, sujetó aquella mano y gritó también. […] De pronto le dio el ahogo [ a Pino]. Las lágrimas la envolvían, la hacían temblar. Vino como siempre la pataleta[35]…
Dans les deux romans, la majorité des relations entre adultes, et en particulier les relations amoureuses, consiste à exercer sur l’autre un pouvoir absolu et à s’en servir pour le détruire ; ce sont des relations sadiques qu’exerce Román sur Juan et ce dernier sur Gloria (dans Nada) et qu’exerce (dans La isla y los demonios) José sur Pino et sur son oncle Daniel, mais qu’a également exercées, dans une certaine mesure, le père de José sur Teresa, sa seconde femme. Or, ce que Carmen Laforet analyse avec une étonnante lucidité dans ses deux premiers romans, c’est que ces relations sadiques supposent aussi un certain masochisme de la part de celui ou celle sur qui elles s’exercent, démontant les mécanismes qui peuvent conduire un individu à en martyriser un autre ou à se laisser martyriser.
Le jeu, apparemment simpliste, qui consiste à opposer l’univers noir de la famille d’Andrea à celui d’Ena se complique progressivement au cours du roman, preuve de la grande maturité de romancière. La première entorse à la division entre ces deux mondes apparaît dans le cinquième chapitre, lorsqu’Ena déclare à Andrea : « -He averiguado hoy que un violinista de que te hablé hace tiempo ¿te acuerdas?… además de llevar tu segundo apellido, tan extraño, vive en la calle Aribau como tú. Su nombre es Román. ¿De veras no es pariente tuyo[36]? ». Andrea ayant admis qu’il s’agissait de son oncle, Ena lui demande alors de le lui présenter. Andrea qui avait réussi, jusque-là, à éviter tout contact entre l’enfer que représente pour elle l’appartement de la rue Aribau, et le paradis symbolisé par celui de la Via Layetana, ne peut empêcher son amie de détruire ce cloisonnement puisqu’Ena rend régulièrement visite à Román et entame avec lui une relation complexe. Mais c’est l’étrange confession que fait à Andrea la mère d’Ena au début de la troisième partie du roman qui bouscule totalement les perspectives. En avouant à Andrea qu’elle fut amoureuse de Román dans sa jeunesse, d’un amour masochiste, la mère d’Ena montre à la narratrice que, contrairement à ce que celle-ci imaginait, la violence destructrice de la passion n’est pas l’apanage de sa famille et qu’une jeune fille de bonne famille ayant reçu une excellente éducation, peut se laisser piétiner par l’objet de son amour. La mère d’Ena raconte comment Román lui demanda un jour de couper sa magnifique tresse pour la lui donner (« -No eres capaz de cortártela para mí -dijo, brillándole los ojos[37].»), comment elle lui obéit, lui envoya sa tresse et quelle fut la réaction de Román : « Me miró con curiosidad. Me dijo: -Tengo lo mejor de ti en mi casa. Te he robado tu encanto – luego concluyó impaciente-: ¿por qué has hecho esa estupidez, mujer? ¿Por qué eres como un perro para mí[38]? » Et la mère d’Ena conclut : « Ahora, viendo las cosas a distancia, me pregunto cómo se puede alcanzar tal capacidad de humillación, cómo podemos enfermar así, cómo en los sentidos humanos cabe una tan grande capacidad de placer en el dolor[39].»
Elle donne donc bien une parfaite définition du masochisme. Et la subtilité de Laforet va plus loin, en faisant de la blonde Ena un être plus compliqué qu’Andrea ne l’avait imaginé. Ena explique à son amie les raisons qui l’ont poussée à rencontrer Román et la manière dont a évolué leur relation :
-¿Tú sabes que mi madre estuvo enamorada de él en la juventud? … Sólo por este hecho deseaba conocer yo a Román. Luego ¡qué decepción! Llegué a odiarlo… ¿No te sucede a ti, cuando forjas una leyenda sobre un ser determinado y ves que queda bajo tus fantasías y que en realidad vale aún menos que tú, y llegas a odiarle? A veces ese odio mío por Román llegó a ser tan grande, que él lo notaba y volvía la cabeza, como cargado de electricidad… […]
Si estoy con Jaime me vuelvo buena, Andrea, soy una mujer distinta… Si vieras, a veces tengo miedo de sentir el dualismo de fuerzas que me impulsan. Cuando he sido demasiado sublime una temporada, tengo ganas de arañar… De dañar un poco. […]
¿Te asusto? Entonces, ¿cómo quieres ser mi amiga? No soy ningún ángel, Andrea…[40]
[…] Si tú supieras que Román, cuando era joven, hizo sufrir a mi madre…
Pero no me creas mejor de lo que soy, Andrea… No vayas a buscarme disculpas… No era sólo por esta causa por lo que yo quería humillar a Román… ¿cómo te voy a explicar el juego apasionante en que se convertía aquello para mí? … Era una lucha más enconada cada vez. Una lucha a muerte…[41]
Et c’est Ena qui sort vainqueur de cette lutte à mort puisque Román se suicide. La blonde Ena refuse l’angélisme que lui avait attribué Andrea, avoue avoir pris plaisir à faire souffrir Román, pas seulement pour venger sa mère, et définit indirectement son propre désir de faire le mal comme une pulsion en employant l’expression « fuerzas que me impulsan ». Elle annonce ainsi les mots de Marta dans le roman suivant, dont le titre contient déjà le mot « demonios », mot qui sera décliné inlassablement au fil des pages : la propriété où vivent Marta, son frère José et Pino, est qualifiée de « endemoniada »[42], Pino de « demonio »[43] ; c’est sous la forme d’un démon que le peintre Pablo représente Hones (« vio un apunte de demonio con patas de cabra »[44]), entre autres exemples innombrables.
Les démons qui hantent Pino sont ceux de la jalousie, de la frustration et de la haine qu’elle éprouve, en particulier, pour Teresa, la mère de Marta, tombée dans une léthargie proche de la démence et dont elle s’occupe avec une rare violence : « -Déjate ver, estúpida. Tienes visita. […] Por esta porquería… por ésta, soy yo una mujer desgraciada […] Y tiene buena salud la maldita… Nada le hace daño[45]. » ; ceux qui hantent José sont le désir de revanche. S’il invite à La Palma, pendant la Guerre civile, son oncle Daniel, la femme de celui-ci et la tante Hones, c’est uniquement pour se venger : « Desde que sus tíos escribieron hablando de su desesperada situación, José había pensado en muchas cosas, pero sobre todo en devolver una por una mil humillaciones antiguas[46]… » Il ne manquera pas une occasion d’humilier Daniel qui n’avait jamais perdu une occasion de l’humilier quand il était enfant et qui a également humilié Matilde, sa femme, au début de leur mariage : « Matilde recordaba con horror los primeros meses de su matrimonio. Todas las timideces de Daniel en la calle eran despotismos en casa, y voces fuertes[47]. »
Dans La isla y los demonios c’est, bien sûr, dans les relations entre hommes et femmes que se manifeste le plus clairement le sado-masochisme et, les cas présentés dans la fiction montrent que les rôles ne sont pas liés au sexe. C’est Pablo la victime dans la relation qu’il entretient avec sa femme : « Jamás encontró a nadie que le aprisionara de tal manera. Vivir con ella había sido un sufrimiento, pero también un placer comparable al que proporcionan algunas drogas. […] Junto a María era un hombre hundido[48]. » Dans ce cas c’est la femme qui dispose, de plus, du pouvoir économique, mais parfois richesse, jeunesse et beauté ne mettent pas la femme à l’abri d’une dépendance asservissante. Teresa, une jeune femme riche a épousé Luis, totalement ruiné. Or, comme le rappelle José, c’est pourtant elle qui vivait les affres de la jalousie :
Aquel hombre, mucho mayor que su mujer, no le hacía gran caso. Pasaba todo el tiempo posible lejos de ella. A Teresa le contaban que tenía amantes. Ella llegó a utilizar a José para que averiguase la verdad de tales historias, y el chico, sombrío y sintiéndose a un tiempo muy importante, le contaba todos los chismes que podía recoger en la ciudad acerca de su padre. Luego veía llorar a Teresa, enfadarse con Luis, y encerrarse en interminables charlas con la majorera[49].
Comme le lecteur l’avait découvert peu à peu dans Nada, la couleur des cheveux ou de la peau n’est pas révélatrice et le blond José n’est pas toujours présenté comme l’être froid et maître de lui qu’il voudrait être : « La ambición de José había sido siempre la de ser un hombre sin nervios. Su padre decía de él que tenía vocación de lord inglés, una vocación completamente fallida porque era precisamente lo contrario de su manera de ser[50] ».
Dans La mujer nueva, le personnage dévoré par la passion, et ayant bien des difficultés à dominer ses pulsions est Paulina alors qu’Eulogio paraît calme et réfléchi ; il semble donc qu’à nouveau Laforet associe la passion (qui pour elle est toujours destructrice) à un type physique, concrètement le type méditerranéen, la maîtrise de soi étant associée au type nordique. Cependant, grâce à la foi, Pauline arrive à contrôler ses pulsions. C’est surtout le personnage de Blanca qui a, dans la construction symbolique, une fonction paradigmatique ; dans ce cas c’est d’abord le prénom qui est signifiant, puisque cette femme est l’image même de la pureté, de la bonté et de la foi ; c’est elle qui amène Paulina vers Dieu, c’est elle qui l’aide tout au long de son cheminement vers la pureté. Et les rares détails physiques qui sont donnés, à une exception près, ne permettent pas d’approcher la vérité du personnage : « una señora gorda que a la primera impresión parecía un ama de llaves distinguida, vestida con un traje parecido a una sotana o un saco negro, peinada con un rullito de cabellos grises en la nuca y con una cara sonriente y sonrosada como una criatura, y unos ojos verdosos como los de Rita, unos ojos de una asombrosa limpidez, de niño[51]. » Le seul détail physique signifiant n’est pas inné, il ne s’agit pas d’une couleur de cheveux, de peau ou d’yeux, mais de ce qui exprime l’âme : le regard limpide d’un enfant.
La morale, très claire, du roman est que chaque être est libre de choisir le bien, de dominer ses pulsions, et qu’il ne faut pas, alors, chercher dans les caractéristiques génétiques les explications au comportement[52]. Les difficultés matérielles et sociales ne suffisent pas non plus à justifier la violence ou la folie. Dans Nada, la faim semblait en grande partie responsable du comportement de Juan (« Pensaba en Juan y me encontraba semejante a él en muchas cosas. Ni siquiera se me ocurría pensar que estaba histérica por falta de alimento[53] »). Ce n’est plus du tout le cas dans La isla y los demonios et, dans La mujer nueva, le système des personnages complique encore plus le problème. Un personnage secondaire, Julián : « que había crecido entre gentes sin dinero que vivían obsesionadas por el deseo de placeres materiales[54] », symbolise une forme très classique du mal : il assassine la femme de son employeur chez qui il pensait voler des pierres précieuses. Le récit construit, avec Julián, un personnage sans morale, exclusivement intéressé par les biens matériels et donc prêt à tout pour les obtenir ; mais ce qui est original, c’est que l’épisode consacré à Julián est développé parallèlement à celui du retour d’Antonio qui veut reconquérir Paulina. Le lecteur est ainsi amené à percevoir des ressemblances entre les deux personnages. « Va como un animalito a todo lo que desea[55]. » Cette phrase définit la conduite de l’un et de l’autre, or c’est Antonio qui est visé par Blanca. Laforet suggère alors que le mal fait par Antonio, qui trompe sa femme mourante, refuse la rupture que Paulina souhaite et considère la satisfaction de ses désirs et de ses pulsions comme seule norme de conduite, est de même nature que celui commis par Julián, même si, dans le premier cas, il n’y a pas assassinat. Le caractère sadique du pouvoir exercé par Antonio sur Paulina était d’ailleurs suggéré au début du roman : « Sabía que levantaba en él algunos instintos de crueldad y que le gustaba más que nada verla sufrir[56]. »
Or c’est encore une relation sado-masochiste que montre La insolación. Les héros de ce roman sont trois adolescents : Martín, Anita et Carlos Corsi. Martin est littéralement envoûté par Anita et Carlos, par leur originalité et leur aisance[57]. Se crée alors, sous une forme certes plus atténuée que dans la relation entre Román et la mère d’Ena, mais cependant de même nature, une dépendance affective et une soumission de Martín dont profitent avec une cruauté certaine Carlos et Anita :
No podía separarse de los Corsi. No podía ni pensar en un día sin ellos […]
Una tarde los Corsi no lo llamaron y Martín se aventuró a entrar en la finca. Frufrú le indicó vagamente que buscase a los chicos en el pinar. Martín se hartó de llamarlos a voces, y cuando ya renunciaba, cansado, a aquella búsqueda, oyó sus cuchicheos y sus risas como en los primeros días en Beniteca, cuando le acechaban. Espoleado, siguió llamando y buscando, y una y otra vez intentó renunciar […] Más de una hora tuvieron a Martín practicando este juego de buscarles y cuando aparecieron de pronto, chillando a espaldas suyas, fingieron gran sorpresa al verle. Martín intentó enfadarse y Anita se encogió de hombros.
-Martín pescador, ésta es nuestra casa. Hacemos lo que queremos y si no te gusta puedes no aparecer más.
Martín pensó muy seriamente en no aparecer más -pero mientras lo pensaba no se iba de allí de junto a ellos-. Se despidió con aire digno al terminar la tarde sintiendo que la garganta le dolía y con el ceño fruncido al despedirse. Al día siguiente, apenas despertó, pudo oír que le llamaban ya detrás de la casa, junto al portillo. Antes que ningún día. Se le olvidó todo su enfado[58].
Laforet décrit avec beaucoup de finesse la complexité des liens unissant Martín aux enfants Corsi : la sensation de manque éprouvée par Martín lorsque ses deux amis lui font faux-bond, la colère, le sens de la dignité, et l’habileté d’Anita et Carlos qui ne veulent pas perdre un admirateur si fidèle et docile : « Martín sólo contaba cuando era él la diversión, la compañía, el aplauso que necesitaban. Martín sabía todo eso aquella tarde y sin embargo la tarde se le iba de prisa, de prisa, corta[59]. » Alors que Martín ne peut se passer de Carlos et Anita, ceux-ci quittent Beniteca sans même lui dire au revoir :
Aquella noche casi no pudo dormir. Esperó mucho tiempo en la azotea una llamada, un aviso. Esperó bajo una agria luna en cuarto menguante a que los Corsi se acordasen de despedirse de él. […] Se habían ido sin que él pudiera ver, siquiera, el automóvil que los llevaba[60].
Cette amitié passionnelle se complique, d’été en été, par l’attachement très excessif que Carlos éprouve pour sa sœur qui, en grandissant, rêve d’autres aventures que les jeux partagés jusqu’alors. Carlos se retrouve à son tour victime, mais continue d’être le bourreau de Martín. Dans ce premier volume de la trilogie inachevée c’est bien encore sur les relations de dominant à dominé, sur le plaisir éprouvé par celui qui domine à faire souffrir celui qui est dominé, et sur celui que ressent l’apparente victime consentante, que se penche la romancière, même s’il ne s’agit que de l’un des axes de la fiction et si le récit ne permet jamais d’avoir la certitude que Carlos et Anita prennent délibérément plaisir à faire souffrir Martín. Ce doute subsiste dans le second volume : Anita et Martín se retrouvent par hasard et Martín retombe immédiatement sous la coupe de la jeune femme, abandonnant ses projets et tout ce qui constituait son existence, pour partager la vie bohème de la famille Corsi. Mais le jeu de pouvoirs inclut de nouveaux personnages, en particulier la femme de Carlos Corsi, Zoila, qui entretient après son mariage des relations intimes avec son impresario :
Me descubrió su cuerpo para que yo, horrorizado, pudiese ver las marcas de los golpes que le había propinado Díaz. Era una salvajada. Puñetazos, patadas […] Al casarse con Carlos, me dijo, creyó que éste iba a protegerla de Díaz, que había sido su ángel malo desde que casi una niña, con el pretexto de hacer progresar su carrera artística, la protegió a cambio de su entrega[61].
Carmen Laforet semble donc toujours fascinée par l’univers des pulsions pas ou mal contrôlées, par l’univers de la folie. On retrouve d’ailleurs, dans Al volver la esquina, un personnage qui rappelle ceux des premiers romans. Il s’agit de Beatriz, la fille de Jímenez Din, un peintre et restaurateur de tableaux dont Martín est l’élève et l’ami. Cette jeune femme est la proie de pulsions sexuelles incontrôlables (« su sexualidad exacerbada hasta la locura[62] ») ; or le narrateur principal du récit, Martín, ne sait plus trop lui-même s’il a été victime ou s’il a profité du caractère de Beatriz lorsqu’il lui a rendu visite à l’hôpital psychiatrique où elle se trouvait :
Aquel paseo a pleno sol por el barrio de chalets de veraneo deshabitados en aquel mes de marzo. Aquellas tapias, aquel rincón del jardín abandonado. Aquel momento en que me dejé arrastrar por su enloquecimiento. Era yo quien necesitaba el psicoanálisis y no Anita. Quizá pudiera curarme del dolor angustioso que llevaba dentro desde hacía unos días, si supiera por qué cuando aquello sucedió no sentí remordimiento alguno, y sólo al llegar a Madrid comenzó aquella molestia, aquel zumbar de mosquito que espantaba diciéndome que no tenía necesidad de hacer visitas al maestro Din y a su mujer. Y de pronto, desde hacía unos días, desde que supe que iba a verlos, aquel remordimiento que era una enfermedad[63].
La stucture de Al volver la esquina est très intéressante : dans l’exemple ci-dessus la conscience du mal n’a été occultée que pendant quelques semaines et l’on remarque l’allusion faite par le narrateur à la psychanalyse ; or le roman tout entier se présente comme une auto-analyse (ou comme une psychanalyse puisque Martín laisse entendre qu’il essaie de faire resurgir ses souvenirs à la demande d’un médecin[64]). Au fil des pages, c’est-à-dire au fil des souvenirs qui reviennent à la conscience de Martín, le lecteur découvre les évènements qui se produisirent entre le printemps et l’automne 1950 et il comprend que l’oubli correspondait au désir d’enfouir les souvenirs douloureux ou gênants, qu’il est étroitement lié à la conscience du bien et du mal puisque Martín avait « oublié », enfoui au plus profond de lui-même, tout ce qui le confrontait soit à un sentiment intense de culpabilité, soit à une très grande frustration : culpabilité pour l’aventure avec Zoila, frustration pour n’avoir pas compris que l’objet de son amour était Anita Corsi et n’avoir pas su la retenir. Dans ce dernier roman, comme dans La mujer nueva, les pulsions sexuelles, l’amour comme volonté de posséder et de dominer, sont les formes du mal[65], mais Laforet suggère à la fois la nécessité de barrières morales (ce qui maintient sa trajectoire dans la suite logique de La mujer nueva) et l’inefficacité de ces barrières (ce qui l’en éloigne totalement). A la fin du roman, lorsque Martín a réussi à retrouver la totalité de ses souvenirs, il découvre, et le lecteur avec lui, qu’il avait interprété les évènements de façon aussi erronée que confortable : « Durante veinte años o más he pensado en Rilcki como un personaje diabólico, un inductor al mal, alguien que con su simpatía e insinuaciones sobre otras personas me dio una llave para cerrar mi conciencia a la noción del mal y del bien[66]. » Et il admet : « Los datos que me proporcionan las notas que escribo según aparecen los recuerdos desechados, me convencen de que he amañado por alguna razón oculta el orden de los sucesos[67]. » Martín qui, à l’époque des évènements rapportés, pensait avoir des principes[68], admet, vingt ans après, avoir mis en place inconsciemment un dispositif mental qui lui a permis des arrangements avec sa morale. De fait le seul acte moral dont il a été l’auteur à cette époque est d’avoir décidé de reconnaître l’enfant de Beatriz, sans avoir la certitude d’en être le père, et cette décision bouleverse sa vie : « Aquel día conocí a mi hijo. Era mi hijo. Yo sentí esa seguridad al ver al bebé. (…) Fue el principio de una recuperación. Sentir aquella emoción ante el niño me volvió a la realidad[69]… ». Le dernier roman de Carmen Laforet propose ainsi, comme possible remède au mal, ce que proposait le premier avec le personnage de la mère d’Ena.
Cet exemple montre que la romancière suggère par le biais de ses fictions des réponses au Mal. Comme nous venons de le voir, l’une de ces réponses est la naissance d’un enfant, qui était déjà le cas pour la mère d’Ena : « Fue ella, la niña, quien me descubrió la fina urdimbre de la vida, las mil dulzuras del renunciamiento y del amor, que no es sólo pasión y egoísmo ciego entre un cuerpo y alma de hombre y un cuerpo y alma de mujer[70]… ». Or, Beatriz, la mère de l’enfant que reconnaît Martín, a été elle aussi transformée par la maternité qui l’a même guérie de sa démence : … « aunque parezca mentira […] es que este estado de gravidez ha curado a nuestra hija. Razona perfectamente. Se ve a sí misma como una persona que estuvo loca, pero que ahora ha recuperado la razón. Y está loca de alegría por el hijo que espera[71]. »
Dans un article intitulé « La mística masculina en Nada de Carmen Laforet », Sara E. Schyfter analysait la manière dont était présentée la maternité avec le personnage de la mère d’Ena, elle rappelait qu’au moment de la naissance la première réaction maternelle avait été le rejet, ce qui la conduisait à écrire : … [Laforet] « desmitifica el amor materno. » Mais elle ajoutait :
Sin embargo, Ena transforma lentamente a su madre en un ser humano mejor […] Desde una perspectiva feminista, la posición de Laforet tendería a ser ambigua y ambivalente, ya que dentro del contexto de Nada la condición de mujer y la de madre son identidades que se le imponen al sexo femenino y la limitan y la restringen. Sin embargo, al mismo tiempo, la mujer, al llegar a ser madre, forja una identidad separada de la del hombre, y en algunas instancias esto le permite relacionarse con éste de una manera profunda y plena[72].
On peut nuancer cette analyse car dans Nada un personnage masculin annonce déjà le « miracle » que signifie pour Martín la naissance de son fils, il s’agit de Juan qui entretient avec son enfant une relation très tendre ; cet homme violent qui bat sa femme et hurle du matin au soir fait preuve d’une exceptionnelle douceur avec son fils. Il semblerait donc plutôt que Carmen Laforet oppose deux formes d’amour : l’amour passion, qui est souffrance et destruction, et l’amour, maternel ou paternel, qui est don de soi suggérant que ce dernier peut parfois être le remède du premier. Ce n’est pas le seul et Laforet suggère d’autres contre-poisons, développant, curieusement, deux morales assez opposées : l’une fondée sur la foi chrétienne et l’autre, plus proche de l’hédonisme, fondée sur l’instinct vital et les plaisirs immédiats. C’est, bien sûr, essentiellement dans La mujer nueva qu’apparaissent non seulement la foi en Dieu mais aussi le respect des normes de la morale catholique la plus traditionnelle comme seule forme du Bien et seul rempart au Mal. Paulina qui, dans les premiers temps de sa conversion rêve d’absolu, de mysticisme, de vie monacale ou qui critique les vêtements et la morale étroite des militantes de l’Action Catholique, comprend, à la fin du roman, que sa place est celle d’épouse et de mère[73] et accepte même de se soumettre à toutes les exigences de son mari telles que : « soportar inviernos en Las Duras […] sin compañía de ninguna persona de su educación ni de su sensibilidad. […] aprender todas las tareas que se exigen a una señora de aldea al tanto de sus tierras y de sus criados[74]… » Certaines pages de La mujer nueva sont, il faut l’admettre, dignes de la propagande du « national catholicisme » que la romancière critiquait dans Nada avec le personnage d’Angustias ; c’est par exemple le cas lorsque le texte évoque : « las tres fotografías que ilustraban el libro de Lutero. La primera […] con una cara atormentada, ascética casi, hermosa. La segunda […]: un buen burgués confortable, gozador de la vida […] Luego, los últimos tiempos, un ser abotargado, casi monstruoso[75] » pour reprendre deux pages plus loin le même procédé, en l’inversant, dans l’évocation du père Foucauld[76].
Mais dans tous ses autres romans[77], Carmen Laforet, tout en évoquant les dangers et les limites d’une telle conception de l’existence, se fait aussi l’avocat du plaisir des corps offerts au soleil, à la lumière ou aux bains de minuit. Dès Nada, dans les pages consacrées aux excursions que font Andrea, Ena et Jaime vers les plages proches de Barcelone, plus encore dans La isla y los demonios et La insolación mais aussi dans Al volver la esquina, la romancière écrit le plaisir des sens :
Todas las mañanas Marta nadaba con Sixto hasta un pequeño muelle viejo y abandonado. Allí se sentaban los dos, mojados, risueños, juntos. El cuerpo siente una alegría, una serenidad especial después del ejercicio. Esta alegría flota alrededor de la carne joven, limpia y dorada, esta alegría hace compartir sonrientes a dos muchachos el horizonte luminoso y la costa extendida junto al mar y las salpicaduras de las olas. Fácilmente la vida se serena, los pensamientos son buenos, concretos, sin inquietud[78].
Sale de los recuerdos olvidados aquel primer baño en la noche, en la solitaria playa. Nuestras risas, nuestras carreras después de salir del agua descansados del viaje y felices. Casi con la misma impresión de dicha y de compañerismo con que nos habíamos bañado así, de noche, en la época en que éramos chiquillos. Por unos momentos mágicos estuvimos los tres solos en el mundo: Carlos, Anita y yo[79].
Il faut cependant signaler une évolution dans les romans successifs : les personnages adolescents apparaissent souvent capables de résister au mal (c’est le cas d’Andrea, de Marta et du Martín de La insolación) à la fois parce qu’ils sont mus par une énergie vitale qui les protège et parce qu’ils sont encore purs, c’est-à-dire indifférents aux pulsions et au désir des corps -Andrea semble ignorer l’amour, Marta éprouve un amour platonique et dénué de tout désir pour Pablo, quant au Martín de La insolación, le lecteur le voit vieillir d’été en été et éprouver ses premières émotions sexuelles, c’est sa pureté qui l’emporte cependant-. Or, dans les romans de Laforet, cet état ne survit pas à l’adolescence et le plaisir innocent des corps n’apparaît plus que comme un instant exceptionnel lorsque les personnages ont atteint l’âge adulte. La permanente hésitation entre hédonisme et puritanisme semble donc être une marque de la pensée et de l’écriture d’une romancière cherchant inlassablement des remparts contre les démons.
L’art apparaît, parfois, comme une réponse possible car il transforme en énergie positive les pulsions destructrices. Pablo, dans La isla y los demonios est l’apôtre de la création artistique :
El arte, según Pablo, era el único camino de salvación personal. El único consuelo de la vida. […] -Eso -decía Pablo en un tono que podía ser de broma-, la salvación del infierno… El arte salva del infierno de esta vida. Todos los demonios que están dentro de uno se vuelven ángeles por el arte[80].
Mais Pablo, à la fin du roman, choisit de retourner vivre avec sa femme, alors qu’il se sait incapable de peindre auprès d’elle :
El arte es un demonio que empuja… Pero el amor, cuando se convierte en un pecado como el mío, lo aplasta todo, chupa la sangre y la vida… El arte se va… Y no importa entonces[81].
Aquella noche se preguntó desesperado si la alegría de crear era suficiente para compensar la pérdida de aquel esplendor vital que le daba a todo la presencia de su mujer, y si, en definitiva, él como pintor podía hacer algo tan bueno que mereciera aquel sacrificio de renunciar a su sufrimiento y a su felicidad[82]…
C’est également en l’art que Martín mettait tous ses espoirs : « Ayer me di cuenta de lo que era mi verdadero destino en la vida. Me di cuenta de la fuerza que puede tener un hombre para crear[83]. » Or, dans le second roman dont il est le protagoniste, Martín renonce à la peinture et décide de se consacrer à la restauration et à l’expertise de tableaux, ayant cessé de croire à son talent, mais aussi au caractère salvateur de l’art.
Que serait devenu ce personnage dans le troisième volume ? Le lecteur ne le saura jamais, et il ignorera donc toujours si la romancière avait redonné à l’expression artistique sa valeur de défense contre les démons ; mais son silence laisse supposer que pour elle, comme pour ses personnages, les démons intérieurs avaient triomphé. De même, si Nada et La isla y los demonios s’achevaient sur une note d’espoir, l’héroïne s’apprêtant à commencer une nouvelle vie, les romans suivants proposent une philosophie moins optimiste ; il s’agit dorénavant d’éviter le pire, d’essayer de ne pas être trop malheureux, de ne pas faire trop de mal, avec la foi comme guide dans La mujer nueva ou simplement une certaine résignation morose dans les deux derniers romans. Dans La insolación et dans Al volver la esquina les démons rôdent, menacent et si le jeune Martín avait pu trouver refuge auprès de sa grand-mère après avoir été chassé par son père, l’adulte doit affronter seul ses peurs et ses contradictions. Le dernier roman de Laforet joue parfois sur l’humour, la distance ironique, mais sa tonalité générale est grave comme si la romancière contemplait avec angoisse la faiblesse de l’être humain face à son inconscient.
[1] Carmen Laforet, Nada, Barcelone :ed. de ref. Destinolibro, n° 57, cinquième édition, 1984, p. 25.
[2] Carmen Laforet, La isla y los demonios, Barcelone : ed. de ref. Destinolibro, n°38, deuxième édition, 1991, p. 306.
[3] « Durante tres años he trabajado mucho para una sola novela: la que en esta TRILOGÍA lleva el nombre de Jaque Mate.[…] Un día vi que en estos datos tenía, terminadas, tres novelas diferentes. Tres novelas que constituyen, cada una de ellas, un mundo cerrado y acabado.
Siguiendo el orden de mi trabajo, con una técnica casi policíaca, yo debería de haber comenzado por publicar Jaque Mate, después Al volver la esquina y sólo al final La insolación. He preferido, después de pensarlo, conservar el orden cronológico que enlaza los tres libros… » Carmen Laforet, prologue de La insolación, Barcelone : ed. Planeta, 1963, pp. 7-8.
[4] « Historia de una novela », prologue d’Agustín Cerezales pour Al volver la esquina, Barcelone : Ediciones Destino, 2004, p. 8.
[5]Nada, p. 103.
[6]La isla y los demonios,p. 130.
[7]La isla y los demonios, p. 168.
[8]Ibid., p. 293.
[9]La isla y los demonios,p. 296.
[10] La mujer nueva, ed. de ref. Barcelone : Destino, 2003, p. 65.
[11]La mujer nueva, p. 65.
[12]Ibid., p. 66.
[13] Ibid., p. 78.
[14]Ibid.,p. 115.
[15]La insolación, p. 187.
[16]La insolación, p.162.
[17]Ibid., p.135.
[18]Al volver la esquina,p. 74.
[19] Ibid., p. 75.
[20]Nada, p. 17.
[21]Ibid.,p. 15.
[22]Ibid.,p. 183.
[23]Ibid.,p. 15.
[24]Nada, p.120.
[25]Ibid., p. 60.
[26]Ibid.,p. 113.
[27]Ibid.,p. 91.
[28]La isla y los demonios, p. 12.
[29]Ibid., p. 12.
[30]La mujer nueva,p. 32.
[31]Ibid., p. 32.
[32]Al volver la esquina, p. 41.
[33]Ibid., p. 96.
[34]Nada, p. 128.
[35]La isla y los demonios, p. 115.
[36]Nada, p. 61.
[37]Ibid., p. 234.
[38]Ibid., p. 235.
[39]Ibid., p. 235.
[40] Ibid., pp. 264-265.
[41] Ibid., pp. 266-267.
[42]La isla y los demonios, p. 84.
[43]Ibid., p. 85.
[44] Ibid., p. 91.
[45]Ibid., pp. 83-84.
[46] Ibid.,p. 78.
[47] Ibid.,p. 262.
[48]Ibid., pp. 212-213.
[49]Ibid.,p. 280.
[50]Ibid., p. 269.
[51]La mujer nueva, p. 39.
[52] « Comprendió -¡ahora, qué bien!- el infierno, esa privación de amor adonde conduce la adoración idolátrica de la miseria de uno mismo, e incluso ese padecimiento físico del infierno. Comprendió cómo el infierno se escoge por un acto libre de voluntad. » La mujer nueva, p. 157.
[53]Nada, p. 140.
[54]La mujer nueva, p. 195.
[55]La mujer nueva,p. 178.
[56]La mujer nueva, p. 68.
[57] « no se parecían a otros muchachos de su edad que Martín conocía » La insolación, p. 113.
[58]La insolación, pp. 81-82.
[59]Ibid., pp. 89-90.
[60] Ibid., p. 264.
[61]Al volver la esquina, p. 206.
[62] Ibid.,p. 187.
[63] Ibid., p. 187.
[64] « me ha prohibido la doctora que lo mezcle a mis recuerdos en este relato » Al volverla esquina,p. 131.
[65] Dans La mujer nueva, le narrateur notait : « nunca iba a poder prescindir de ciertos anhelos ocultos y brutales que había despertado ella misma, al vivir, en su cuerpo. Nunca podría volver a la inocencia… », op. cit., p. 121.
[66]Al volver la esquina, p. 227.
[67] Ibid., p. 228.
[68] « Mi conciencia me decía que yo era un hombre con una repugnancia instintiva hacia el mal dondequiera que se encontrase. » Ibid., p. 170.
[69]Ibid., p. 283.
[70] Nada, p. 240.
[71]Al volver la esquina,p. 270.
[72] Sara E. Schyfter « La mística masculina en Nada, de Carmen Laforet » Novelistas femeninas de la postguerra española, José Porrúa Turanzas, Madrid, 1983, p. 92.
[73]« No había sido llamada a la soledad de los contemplativos en un convento, ni tampoco le había sido negado un gran sacrificio inicial en esa llamada de Cristo (…) Su camino de perfección debía de estar marcado por el íntimo despojo de aquellos a los que Dios quiere llenar de luz, pero en apariencia era el más simple y el más anódino: la realización total, en cuerpo y alma, de su abandonado matrimonio con Eulogio. » La mujer nueva,p. 329.
[74]Ibid., p. 331.
[75]Ibid.,p. 209.
[76]Ibid., p. 211 : « La primera era de su juventud de elegante parisiense […] Algo blando y cínico […] La segunda fotografía era de los primeros tiempos de su conversión. Una cara interesante de hombre en lucha. La tercera, de sus últimos tiempos: la cara más espiritual, más ascética, inteligente y dulce que uno puede imaginar. La cara de un santo. »
[77] Remarquons cependant, dans Al volver la esquina la présence d’un ami de Martín qui passe de l’anticléricalisme féroce à la vie monacale ; mais cela reste un mystère pour Martín et ne l’aide pas à trouver son propre chemin.
[78]La isla y los demonios,p. 160.
[79]Al volver la esquina, p. 249.
[80]La isla y los demonios, p. 120.
[81]Ibid., p.141.
[82]Ibid., p. 213.
[83]La insolación, p. 319.