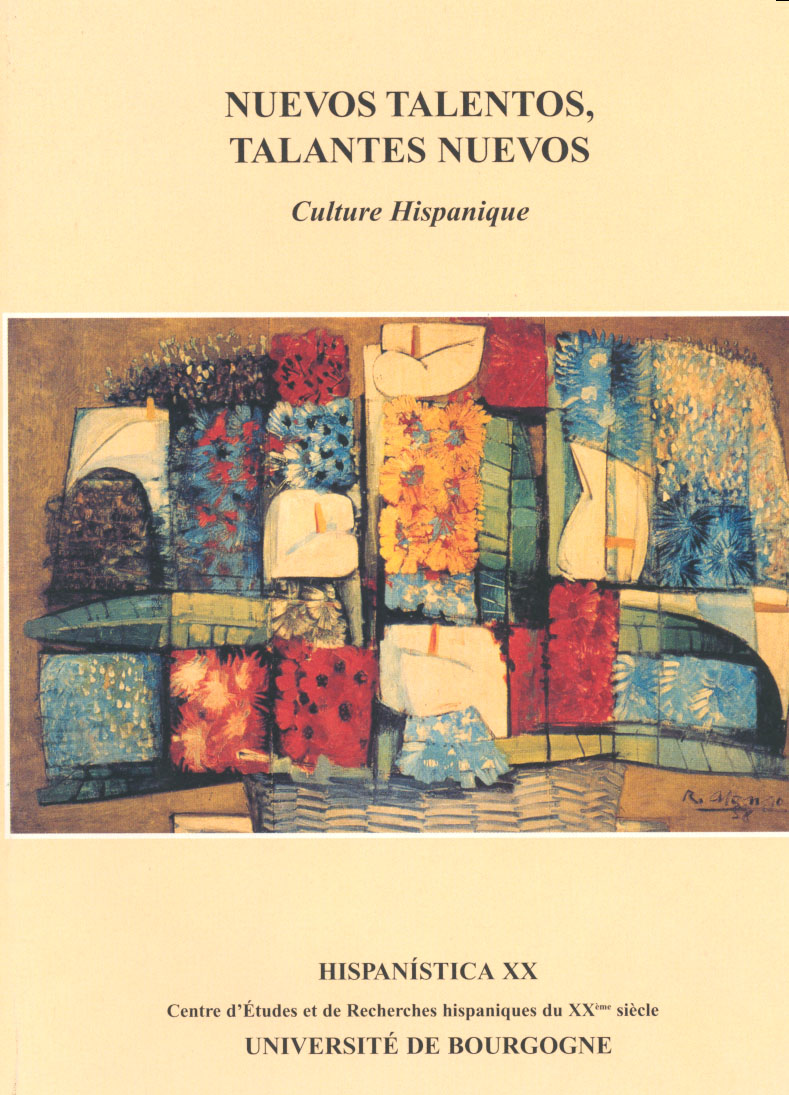Prix : 16,77 euros + frais postaux
n°18
Sommaire :
Christian BOIX : Bélen Gopegui : La conquista del aire
Marie-Christine MOREAU : Espido Freire : Melocotones helados
Michelle TANON-LORA : Ignacio Martínez de Pisón : Les analogies narratives, thématiques et spatio-temporelles dans El fin de los buenos tiempos
Dorothée MOULIN-COMBES : Talent (tardif ?) de l’âge mûr : Luis Landero romancier
Anne LENQUETTE : Ray Loriga, narrador de la generación X y novelista de la modernidad
Catherine ORSINI-SAILLET : La mémoire du traumatisme, un exemple de récit d’enfance : París de Marcos Giralt Torrente
Denise BONNAFFOUX : Enigme d’hier, énigme d’aujourd’hui, Arturo Pérez-Reverte, maître du suspense dans La Tabla de Flandes
Corinne MONTOYA-SORS : La Reave Party de Pinocchio (Éxtasis de Mariano Barroso)
Nicolas BONNET : Un aspect de l’adaptation cinématographique du conte de Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar, par le réalisateur italien Enzo D’Alo : le traitement ironique de la figure de l’auteur
Dorita NOUHAUD : Horizontes lejanos, nuevas perspectivas
Monica ZAPATA : Argentinas, escritoras y de buen talante
Marie-Madeleine GLADIEU : Daniel Veronese, Ana Alvarado et le “Periférico de objetos” : un aspect du nouveau théâtre argentin
Lire un article
et le « Periférico de objetos » :
un aspect du nouveau théâtre argentin
Marie-Madeleine Gladieu
Université de Reims
Après avoir commencé sa carrière comme marionnettiste au Théâtre San Martin, de Buenos Aires, et avoir participé à la représentation d’Ubu Roi, Daniel Veronese voit bientôt dans l’utilisation, parmi les acteurs, de poupées, mannequins et marionnettes une possibilité de renouveler au théâtre l’expression de l’humain. Ubu Roi montre, grâce à la caricature des comportements humains, ce que ceux-ci peuvent avoir de monstrueux dans un univers où les seules valeurs sont la domination et la soumission, où l’arbitraire a force de loi, sous une dictature pour parler clairement.
Veronese, qui écrit ses premières pièces dès le début des années quatre-vingt-dix, affirme sa volonté de montrer de l’homme ce que seul le théâtre peut révéler, de créer un teatro de sabotaje al espectador, un teatro descentralizado que va a conformar un espacio de creación inexplorado hasta el momento. Loin de flatter le spectateur par des thèmes suscitant son enthousiasme (l’amour, l’héroïsme, l’exaltation des héros ou de certains épisodes de l’histoire nationale, ou des valeurs du monde occidental) ou par le rire, il lui propose d’atteindre une certaine forme de lucidité quant à l’origine des problèmes que connaît la société contemporaine. Les pièces de Veronese pourraient être situées dans n’importe quelle ville d’Amérique ou d’Europe. L’influence de quelques dramaturges et metteurs en scène argentins (Griselda Gambaro, Roberto Arlt), celle de Beckett, mais aussi celle de Freud se penchant sur « l’inquiétante étrangeté », ou encore celle de certains peintres (Francis Bacon par exemple), se traduit par la création d’un nouveau théâtre de la cruauté, bien que non inspiré directement par Artaud.
Les œuvres de Veronese ont été jouées dans divers théâtres de Buenos Aires, nationaux et municipaux, dans des centres culturels, et dans un petit théâtre, ancienne maison particulière dont le patio sert de scène et de salle de spectacle, el Callejón de los deseos. Les décors sont réduits à leur plus simple expression (les murs d’une pièce, une fenêtre, une porte, une table et quelques chaises), ainsi que les accessoires. Par conséquent, l’attention du spectateur est retenue par les acteurs et par les mannequins pouvant parfois se confondre avec eux (dans Máquina Hamlet par exemple, pièce écrite par Heiner Müller et adaptée par Veronese, Alvarado et García Wehbi pour le Periférico de Objetos, mise en scène par Veronese) pour renforcer la tension dramatique (la mise en scène de cette même pièce demande que l’on laisse croire au public qu’un spectateur tiré au sort devra participer à l’action qui se déroule sur scène). Les pièces de Veronese ont été souvent primées. Elles commencent à être publiées (Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie, aux éditions Florida Blanca, Buenos Aires, 1995, et quatorze pièces réunies sous le titre Cuerpo de prueba par des éditions universitaires de l’Université de Buenos Aires, en 1997), mais beaucoup sont encore à l’état de tapuscrit.
Ajoutons que Veronese a donné des représentations, depuis près de dix ans, dans plusieurs pays d’Amérique, en Allemagne, et qu’il a participé au festival d’Avignon en 1998, ce qui lui a valu un article élogieux dans Le Monde, mais pas d’invitation sur une scène parisienne : l’Argentine sans tango, sans football, sans folklore en un mot, déroute encore.
Les personnages sont peu nombreux, cinq à six au maximum. Dans la trilogie constituant Música rota, représentée en 1994 au Centre Culturel Ricardo Rojas, Señoritas porteñas et Luz de mañana en un traje marrón, seuls deux personnages interviennent, Señora et Señorita, Hombre et Mujer, et Luisa, dans la pièce en un acte qui porte son nom, est seule sur scène. Cette trilogie traite le thème du désir, toujours fait d’attirance entre les sexes et d’insatisfaction. Les textes sont courts, comme c’est souvent le cas chez Veronese, car les déplacements sur la scène, les gestes et le jeu des acteurs rendent superflus monologues et dialogues. L’importance des volumes donnés à voir, immobiles ou en mouvement, rappellent au spectateur que l’être humain se définit aussi par le volume qu’il occupe dans l’espace et sur la surface du globe terrestre, que les fameux élans du cœur ou de l’âme sont aussi matière et géométrie. Le monologue de Luisa exprimant une frustration qu’elle refuse pourtant de tout son être, n’est pas très différent des répliques d’autres personnages féminins dans le cadre de dialogues, ou de ce qui devrait apparaître comme tel, car chacun(e) semble plus volontiers poursuivre un long monologue que tenter une réelle communication avec l’autre. Comment, dans ces conditions, deux désirs pourraient-ils se rejoindre autrement que dans l’imaginaire de chacun ? Remarquons aussi que les personnages portent des noms génériques (l’homme, la femme, la demoiselle), ou bien des prénoms courants, sans originalité (Luisa, Isabel dans Formas de hablar…), ou ailleurs, des noms de famille très répandus (Gómez, Rodríguez : toutefois, dans Los corderos, la femme est appelée par son nom de famille, tandis que son époux est Luis, et leur fille, plus anonyme encore, Hija). Il ne s’agit donc pas de présenter un cas particulier, une exception, mais au contraire la règle commune. Il ne s’agit pas non plus de tomber dans la banalité du mélodrame, spectacle dont chacun peut sortir les larmes aux yeux mais fort de sa bonne conscience, mais bien de mettre en évidence ce qui, dans le comportement de chacun, blesse ou détruit l’autre. Ou encore, la destruction d’un couple est due au passage d’une mendiante, qui se vêt du seul beau costume que possédait l’homme, laissant la femme physiquement souffrante et incapable d’expliquer de manière rationnelle à son mari pourquoi cette mendiante inconnue l’a suivie jusque dans la chambre conjugale, a trouvé le costume sans le chercher, a menacé la femme d’un geste rappelant celui des jeteuses de sort, et s’est habillée de ce costume masculin. Cette pièce qui ferme la trilogie sur le thème du désir n’a en apparence, par les mots prononcés et l’épisode évoqué, aucun lien direct avec ce thème, si ce n’est le souhait de la mendiante de posséder un beau vêtement. L’essentiel échappe aux mots des personnages, se trouve dans les non-dits, dans les déplacements et les gestes, dans la manière qu’a chacun de s’approprier l’espace. Suivant la femme jusque dans le lieu le plus intime pour le couple, ouvrant le réceptacle de ses trésors, la mendiante prend la place du mari (dans son costume d’abord), et comme lui impose une certaine conduite à son épouse, devenant l’époux métaphoriquement, mais un époux qui ne peut la désirer et qui la quitte, doublement frustrée par le vol et le manque de désir. Le malaise du corps traduit le mal être de la sensibilité, caractéristique que nous trouvons chez un certain nombre de personnages de Veronese, héritée de quelques dramaturges européens du milieu de XXe siècle (Beckett, Ionesco et Adamov en particulier), mais aussi de la tradition antique (« mens sana in corpore sano »). Par conséquent, le titre du premier recueil de pièces, Cuerpo de prueba, qui n’est celui d’aucune œuvre particulière, montre ses diverses significations par rapport à huit ans de création. Le corps matérialise les sentiments et les sensations, et donne à voir, sur la scène, le vécu humain dont il expose la preuve ; c’est lui qui, avant l’esprit, souffre ou éprouve du plaisir : les corps déformés, mutilés, écartelés des tableaux de Bacon sont une mise en garde contre l’abandon des valeurs humanistes et le développement des systèmes totalitaires, et de même les mannequins et les poupées du théâtre de Veronese montrent aux spectateurs, dans les pièces où des actes de cruauté sont directement commis à l’encontre des personnages, dans Cámara Gesell par exemple, permettent d’exorciser en quelque sorte leurs propres tendances à la violence ; c’est encore le corps sur lequel toutes les expériences seront réalisées et qui incarnera les fantasmes de l’imagination, ceux que le théâtre a précisément pour mission de montrer : les personnages de Veronese se livrent très souvent à des jeux cruels tout en affirmant leur douceur, leur soumission (dans Los corderos par exemple) et en dénonçant les actes de violence dont ils ont été témoins dans la rue. Les véritables bourreaux ne sont pas seulement ceux qui sont désignés comme tels : dès qu’il en a l’occasion, chacun torture à sa manière le plus vulnérable, en toute impunité et en toute bonne conscience.
Dans un premier temps, le spectateur et plus encore le lecteur de Veronese serait tenté de voir dans ses pièces la seule dénonciation de la torture, morale essentiellement, qu’un régime dictatorial fait subir à l’être humain. Et il est vrai que, si nous prenons l’exemple de Los corderos, Gómez explique sa présence inattendue au domicile des Rodríguez par un enlèvement dans la rue, un groupe d’hommes l’ayant forcé à monter dans un véhicule et l’ayant déposé devant cette maison. Mais son arrivée sert à révéler qu’en réalité le couple séquestre sa fille, unique apparemment, non nommée (Hija) et d’un âge peu précis (quinze ans ? Ou moins ? Ou vingt ans, comme elle le prétend ?), traitée comme une enfant en bas âge mais qui occupe une bonne partie de la pièce située à l’étage de la minuscule maison. L’agneau que la femme affirme être a pourtant imposé sa volonté et son choix à Luis, son mari qui ne possède qu’un prénom, comme si le nom de famille, l’identité, était l’apanage de sa femme : c’est elle qui, parmi ses prétendants, a choisi son mari, et non l’inverse. Mais ce renversement de situation, qui produit souvent au théâtre des effets comiques, inquiète davantage ici : le sort des autres ne l’inquiète guère, l’enlèvement d’un citoyen dans la rue ne fait naître chez elle aucune compassion pour la victime ; l’un de ses visiteurs annonce, comme un fait banal, qu’un massacre a eu lieu récemment, au coin de la rue : personne ne s’en émeut, chacun vit replié sur soi et communique à peine avec les autres.
Crónica de la caída de uno de los hombres de ella montre un personnage féminin, Margarita, qui se partage entre deux hommes, Evaristo le musicien bossu et Artemio qui lui écrit des lettres d’amour. Une guerre a été déclarée, et Margarita incite les deux hommes à se comporter en héros. Si le passage d’hélicoptères rythme les premières scènes, l’ambiance du treizième tableau est plus précisément marquée par la violence. Podría llegar a morir alguien, avertit sagement Evaristo, mais Margarita, en une reprise parodique du tango de Gardel, les encourage d’autant plus à faire leur devoir et à participer aux possibles batailles. Elle insiste sur le bouleversement des valeurs traditionnelles, elle surveille dans un berceau un enfant dont elle ne connaît pas le père, et attend le retour de ses héros. Evaristo, qui revient du front débarrassé de sa scoliose, est considéré par Margarita comme mutilé, assez paradoxalement. Quant à Artemio, elle lui affirme : debemos ser felices. La félicité et la création d’un couple sont donc des devoirs. Les personnages montrent un comportement souvent robotisé, entièrement conditionné par les valeurs déclarées de la société : des marionnettes pourraient les remplacer dans certaines scènes. L’influence de Freud est aussi évidente, par les obsessions des trois protagonistes : Artemio est obsédé par l’élevage de souris, il regrette que les employés des Postes ne se livrent pas à cette activité, pas plus qu’Evaristo, et Margarita demande à ce dernier s’il sait jouer à matar la rata. Ces allusions au texte célèbre de Freud et à des tendances sexuelles peu conformes aux normes morales de la société occidentale sont d’autres facteurs de tension dramatique. La présence épisodique de Madame Aterrà, qui se livre à d’étranges mesures en traçant sur le sol des figures géométriques très bizarres et en mesurant des ondes favorables ou défavorables avec l’aiguille d’une boussole qui a depuis longtemps perdu le nord, renforce l’inquiétante étrangeté des situations présentées. Le monde a perdu ses valeurs, une « sorcière » recherche le sens de cette vie au moyen d’instruments inadaptés qui ne lui indiqueront jamais le « nord », une guerre rapide et sans raison apparente met en danger la vie des hommes, l’enfant de Margarita ne saura jamais qui est son père… Que se passe-t-il lorsque l’humain est à ce point mis à mal ? Sera-t-il un jour possible de reconstruire un univers cohérent ?
C’est donc bien non seulement aux problèmes de la dictature et des guerres, de la violence, que Veronese s’attaque dans ses pièces, mais surtout à tous les facteurs inhérents à l’être humain qui permettent le développement de situations de violence ou leur acceptation : bourreaux ou victimes, tous doivent s’interroger, se remettre en question. Le théâtre montre tous ces problèmes grâce au corps des acteurs ou à des substituts de ces corps, si la cruauté atteint les limites du physiquement soutenable. Mais le corps, volume, mouvement, expression, moyen matériel de communication (ou d’incommunication), est l’image tangible de l’esprit, de la société, de l’être dans sa totalité. C’est pourquoi la recherche de Veronese et du groupe « Periférico de Objetos », plus encore que sur l’expression lexicale, qui n’est toutefois pas négligée, se centre sur les artifices de la mise en scène et sur un jeu des acteurs permettant parfois de les confondre avec les mannequins présents parmi eux, et sur une scène presque sans décor pour inciter le spectateur à la réflexion. Daniel Veronese et Ana Alvarado créent une expression dramatique peu conformiste, peu tournée vers l’humour, à l’exception de l’humour noir ou de marques de dérision, un nouveau théâtre de la cruauté où le spectateur est toujours remis en cause par le déploiement de cette inquiétante étrangeté qui lui dévoile les aspects les plus cachés, souvent les moins avouables, de l’être.